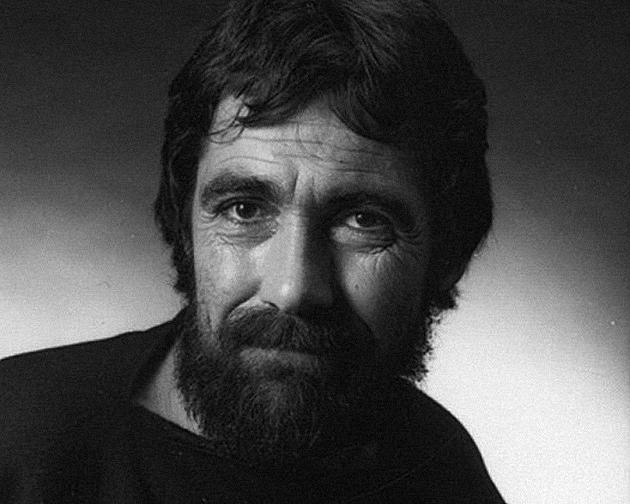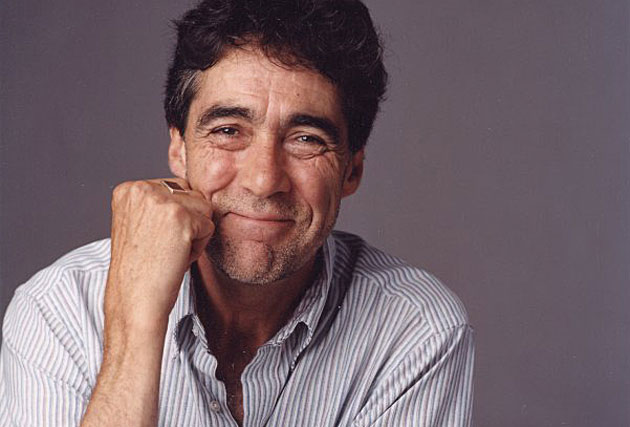J’habite l’arrondissement d’Outremont à Montréal, mais juste. À quelques rues à l’est, c’est le Plateau Mont-Royal. Dans ces rues limitrophes, il y a un grand nombre de familles juives hassidiques. Cela fait plusieurs années que j’habite le quartier et il faut dire que le contact est minimal. On a toujours l’impression, à tort ou à raison, que cette communauté ne s’intéresse pas à «nos» affaires.
Hier soir, j’avais décidé de descendre dans la rue à huit heures pour me joindre à la marche des casseroles du quartier. Depuis l’adoption de la loi spéciale il y a une semaine, ces manifestations «spontanées» se déroulent dans les divers quartiers de Montréal et dans d’autres villes du Québec. Gens de tout âge y sont présents. J’avais assisté brièvement à des marches de casseroles d’autres quartiers, notamment le quartier populaire de Hochelaga et dans le Quartier Latin, mais jamais muni de ma propre casserole.
Il y a presque deux mois, lorsque je vous ai écrit pour faire état de la grève étudiante au Québec, la grève suscitait relativement peu d’intérêt dans le ROC (Rest of Canada). À ce moment-là, Québec refusait toujours de négocier avec les étudiants alors qu’aujourd’hui on parle de négociations entre le gouvernement et les quatre associations étudiantes nationales (la Fédération étudiante collégiale, la Fédération étudiante universitaire, la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante et la Table de concertation étudiante). Une proposition de baisse de la hausse à déjà été faite par le gouvernement. C’est un début.
À ce moment-là, il n’y avait pas encore d’injonctions, de grande manifestation nationale pour la fête de la terre du 22 avril, d’augmentation de la hausse, d’entente bidon ni la démission de la ministre Beauchamp. Il n’y avait pas encore la loi spéciale (l’oie spéciale qui distribue des amandes salées), les manifestations nocturnes, les arrestations de masse qui augmentaient en nombre jusqu’à ce que, selon certains, la bureaucratie policière nécessite quelques soirs de répit avant de recommencer de plus belle. Le 22 mai, il y a eu une autre manifestation nationale contre la loi spéciale qui a réuni jusqu’à 400 000 personnes dans les rues de Montréal. Et bien sûr, il y a deux mois, Anarchopanda n’était qu’un autre prof contre la hausse. Aujourd’hui, le monde entier parle de nous.
Si les manifestations nocturnes demeurent essentiellement étudiantes, les concerts de casseroles rejoignent tous ceux qui sont contre l’atteinte aux droits fondamentaux et ceux qui en ont crissement marre de Charest et de son gouvernement. Et ceux-ci sont de tous les âges.
Je descendais donc dans la rue, armé d’une cuiller en bois et d’une casserole. C’est une expérience tout autre que celles des marches nocturnes. Les manifestations sont plus petites, la présence policière est moindre, donc moins violente. Il y a moins de colère, l’ambiance est plus festive. Pour une première fois, peut-être, les voisins se parlent, se sourient et côtoient. Il n’y a pas de juifs hassidiques dans notre défilé, mais il y en a plusieurs qui nous observent du coin de la rue ou de leur perron. Il y a des hommes qui sourient dans leurs longues barbes en nous voyant, ils doivent trouver ça drôle, étrange. Parfois, je remarque une femme qui tape dans ses mains. Les enfants nous regardent avec émerveillement. Mais il n’y a personne qui se joint à nous.
Après une petite pause concert devant la maison du maire de Montréal, nous poursuivons notre chemin pour enfin rejoindre l’artère principale, l’avenue du Parc. Rendu à l’angle Laurier, je décide de rentrer chez moi plutôt que d’aller jusqu’au centre-ville. Mes jambes me font mal, victimes du déménagement de ma blonde, la veille.
Devant la synagogue à deux pas de chez moi, un groupe d’«adolescents» hassidiques se tient, comme nous nous tenions jadis sur les marches de l’école après la fin des cours. Ils sont quatre ou cinq, ils ont tous l’air d’avoir 15 ou 16 ans. Il fait déjà nuit, le ciel est sombre. Alors que je passe devant eux, j’entends un «Hello».
Je réponds : «Hello».
Je m’apprête à continuer tranquillement mon chemin quand j’en entends un qui m’interpelle.
«Hey, we saw somebody with, under the red square, the black square. What does it mean?»
«It’s for the law»
«So the red is for the students and the black for the law?»
«Yes, against the law that was passed.»
Il explique en Yiddish pour un de ses camarades qui ne doit pas bien comprendre l’anglais.
Ensuite, il dit «We have one too» et il sort un petit carré rouge de la poche de son long manteau noir.
«Thank you» dis-je en souriant, puis «Good night», avant de monter chez moi.
C’est peut-être la plus longue conversation que je n’ai jamais eue avec ces jeunes qui vivent à deux pas de chez moi. Je ne sais pas ce qu’ils pensent vraiment de la grève, du mouvement étudiant. Mais ils sont certainement curieux.
Les choses ont changé au Québec.
Je sais qu’il ne s’agit que d’un fait anecdotique qui n’explique en rien ce qui se passe vraiment au Québec. Mais il est emblématique de l’omniprésence de ce mouvement dans tout ce qui se passe actuellement.
Il y a quelque chose dans l’air qu’il n’y a pas encore dans le ROC.
Alors qu’à l’Assemblée nationale, ceux et celles qui se déclarent la représentation légitime du peuple se préparaient à adopter une loi spéciale draconienne et sûrement anticonstitutionnelle et que dans les rues de Montréal, de Québec, de Sherbrooke et ailleurs, la résistance québécoise se préparait à une énième manifestation, je filais à l’anglaise vers le calme d’une province amorphe où le carré rouge que je portais fidèlement ne provoquait ni la peur aux bourgeois banlieusards ni la fierté aux vieux travailleurs dans les autobus municipaux.
Toronto était calme. Toronto n’était pas concernée par ce qui se passait alors et ce qui se passe toujours à Montréal. Les nouvelles circulaient aussi lentement que les autos des riches de Rosedale en direction de leur petit palais des Muskokas ou des Kawarthas pour fêter la reine du Canada avec une caisse de bière et un coup de soleil. On ne savait donc pas que la politice militarisée matraquait avec encore plus d’impunité. Que les politiciens rétrogrades font l’apologie de la violence sous prétexte que les têtes et les cerveaux d’un jeune ne valent pas la vitrine bien assurée d’une banque qui s’amuse à financer le meurtre par voie de fait minier d’un village entier en Amérique du Sud. Que les dispositions d’une loi matraque sont une machine à remonter dans le temps qui permettent à la ministre Courchesne de défaire et réinterpréter les lois de la province et au premier ministre de se donner des airs de Le Noblet.
Les oiseaux chantaient paisiblement, les gens marchaient dans les rues, désunies, sans scander de slogans. Je me suis permis le privilège d’une fin de semaine paisible alors que les miens étaient sur la place publique à revendiquer en risquant éventuellement de perdre leurs yeux, leurs oreilles ou leur liberté.
Malgré les tentatives d’étaler le beurre d’érable, je me ressentais d’autant plus étranger dans ma ville natale que d’habitude. Toronto avait quelque chose de mort. Il y a quelque chose de vivant dans la résistance, il y a quelque chose de vivifiant dans la revendication. J’espère que le Maple Spread réussit à libérer mon Ontario natal des griffes de Morphée pour qu’il ressente la liberté qui ne vient qu’en la réclamant. Pour le moment, le printemps n’est arrivé qu’au Québec. Mais les saisons ne connaissent pas les frontières.
Je ne sais pas vraiment où je veux en venir, à part vous faire part de quelques impressions. Pour les faits, il faudra aller ailleurs. Je vous laisse avec une chanson de notre chanteur populaire national, Damien Robitaille :
Photo: Steve Duchesne