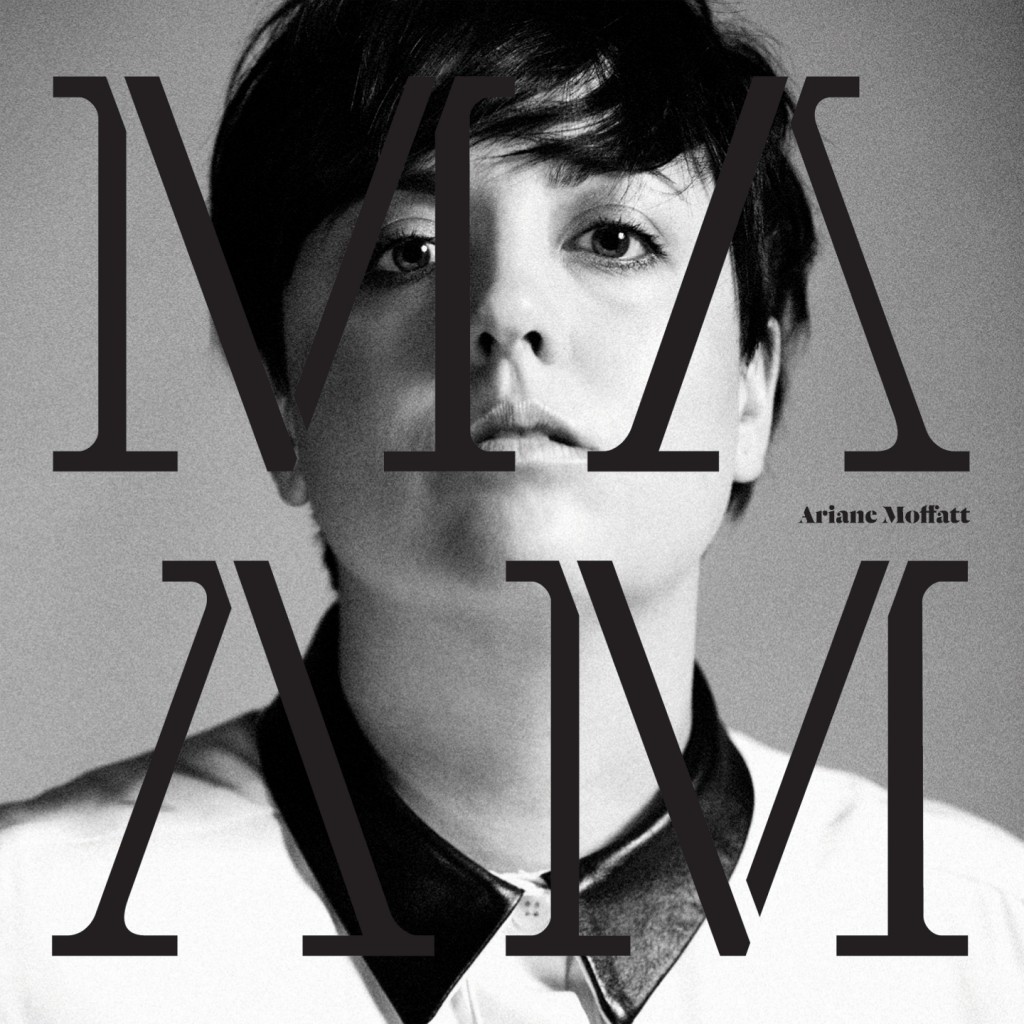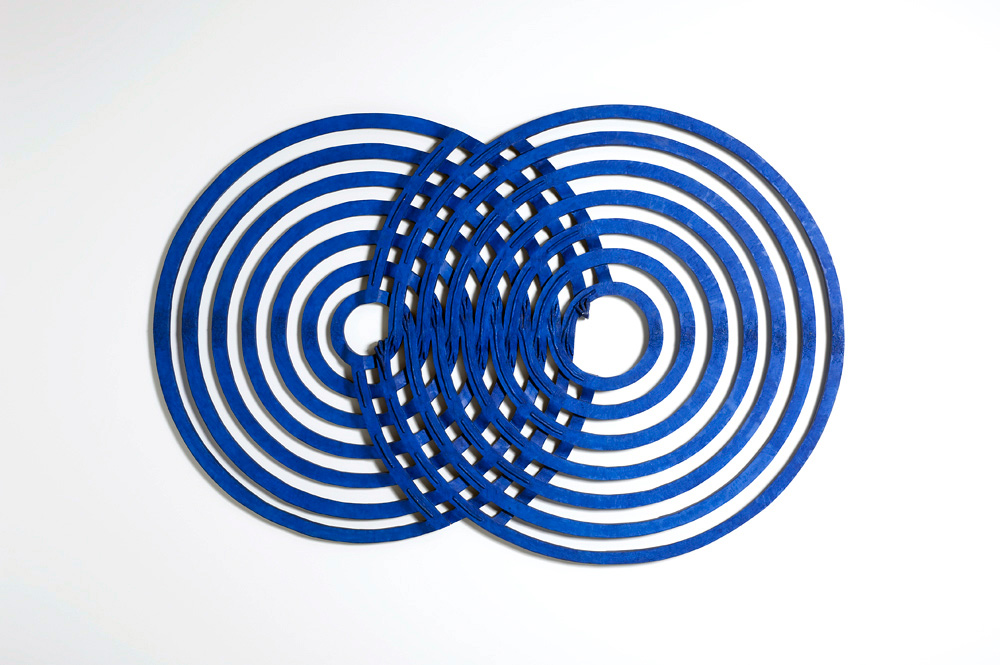C’est samedi que les membres du Nouveau Parti Démocratique choisiront un nouveau chef afin de remplacer – le pourtant irremplaçable – Jack Layton. Il ne fait pas de doute que le parti a accompli quelque chose de tout à fait remarquable lors de la dernière élection. Grâce à Layton, le parti devint, pour la première fois, l’opposition officielle, en remportant un nombre record de sièges à la Chambre des communes. Comme tant d’autres, je me suis laissé emporter par la vague orange; j’ai participé aux rassemblements et j’ai fait campagne à quelques reprises pour le parti. J’étais là, moi, à Montréal, pour le printemps du changement. Quel moment historique quand le NPD a littéralement vidé la province du Bloc québécois. Peu importe s’il s’agissait d’un vote stratégique pour contrer les Conservateurs, la victoire du NPD avait dorénavant réorienté la discussion politique en permettant non seulement au Québec de se joindre à la conversation, mais en donnant finalement lieu à un authentique débat entre la gauche et la droite au Canada.
La tâche du prochain chef est colossale; il (ou elle) devra unifier le parti de façon à assumer la place du NPD en tant que parti officiel de l’opposition, pour espérer obtenir, un jour, le pouvoir à Ottawa. Il n’est pas évident d’essayer de remplacer un chef si charismatique et qui était, incontestablement, au sommet de sa carrière politique au moment de son décès. Cela dit, aucun des candidats à la chefferie ne s’est réellement démarqué au cours des nombreuses semaines de la course.
Une véritable campagne aux signatures
Pas de direction. Pas de vision exceptionnelle pour le parti. Chaque candidat semblait davantage préoccupé à obtenir l’appui des députés néodémocrates pendant la course, notamment celui du cabinet fantôme, plutôt que de se démarquer sur le plan idéologique. Semaine après semaine, les candidats se félicitaient pour chaque signature additionnelle récoltée en publiant des communiqués de presse officiels sur leurs sites personnels. À chaque fois qu’un nouveau député, un nouvel organisme ou, encore, une personne notable appuyait une campagne, la nouvelle circulait de façon démesurée à travers les médias sociaux. Pour les membres du parti automatiquement abonnés à toutes les listes d’envoi des candidats, cette quête aux signatures est rapidement devenue ennuyante. Thomas Mulcair fut certainement le précurseur de cette compétition, brandissant fièrement sa longue liste d’appui dès le début de la course. Même en lisant constamment au sujet des candidats, il était difficile d’être bien informé sur leurs programmes individuels. Le moins que l’on puisse dire est que la surutilisation des médias sociaux au profit de véritables programmes politiques a dévié l’attention des membres du réel objectif de cette course.
Après avoir visionné deux des débats télévisés, exercice relativement pénible tellement les candidats étaient en accord, j’ai perdu intérêt. J’avoue que je me suis sentie un peu triste d’être incapable d’écouter ces débats, moi, la fille qui, jadis, pouvait passer ses journées à écouter des comités parlementaires sur la chaîne CPAC. L’incapacité des candidats à défendre leurs opinions efficacement me rappela les débats de piètre qualité que j’avais eus dans mes classes de politique au secondaire, qui, malgré tout, étaient quand même plus animés. Je ne suis malheureusement pas la seule qui a eu de la difficulté à suivre cette course attentivement; chaque candidat a réitéré sans cesse qu’il était forcément le meilleur choix pour le parti sans pour autant offrir des explications convaincantes à cet effet. À la fin, les nombreux débats étaient devenus inutiles et tranquillement, comme plusieurs autres personnes, je me suis désabonnée des listes d’envoi et j’ai cessé de lire les journaux.
La prise de décision
On ne peut pas dire que la course à la chefferie du NPD a été très mouvementée, mais elle aura un impact décisif sur les politiques canadiennes pour les années à venir. Les tactiques utilisées par les candidats pour attirer les votes ont visiblement aliéné, dans plusieurs cas, les membres du parti. Membres qui, notons-le, avaient déjà manifestement un intérêt pour la course en ayant pris la peine d’adhérer au parti. Sans compter les courriels incessants, qui pouvaient heureusement être bloqués, les appels des candidats furent fréquents tout au long de la course. À un tel point d’ailleurs, qu’il fallait parfois se demander s’il y avait une quelconque coordination à travers les diverses équipes. L’utilisation poussée de ce genre d’outil pour faire du réseautage est, à mon avis, désuète et n’a réussi, de toute façon, à pousser de l’avant aucun des candidats.
En effet, à part quelques blogueurs enthousiastes ayant déjà utilisé leur bulletin de vote, personne ne semble réellement savoir lequel des candidats serait le choix idéal. Les premiers et deuxièmes choix sont devenus, à cet égard, des choix stratégiques. Thomas Mulcair parce qu’il gardera l’appui du Québec. Nathan Cullen puisqu’il coopérera avec les autres partis. Brian Topp pour ses plans économiques. Peggy Nash, car c’est une une grande syndicaliste. Paul Dewar car il… comprend les familles canadiennes? J’oublie. J’oublie précisément les éléments importants des autres programmes. Si c’est tout à fait normal que les candidats aient des positions similaires parce qu’ils sont dans le même parti, le manque de leadership pendant la course a fait en sorte qu’on ne sait toujours pas qui remportera le vote. Rick Mercer résumait instinctivement ce fait cette semaine dans une de ses vidéos:
La présente course à la chefferie du NPD me rappelle bien pourquoi, il y a quelques années, j’ai abandonné l’idée de faire carrière sur la colline. Je n’ai pas toujours fait partie de cette jeunesse apolitique et désintéressée, mais cette course aura inévitablement contribué à nourrir mon cynisme envers la politique canadienne. En attendant de voter, je plonge un peu plus creux, malgré moi, dans le nihilisme…
Photo: Tommy Douglas, ancien chef du NPD (1965), Frank Lennon, Toronto Star