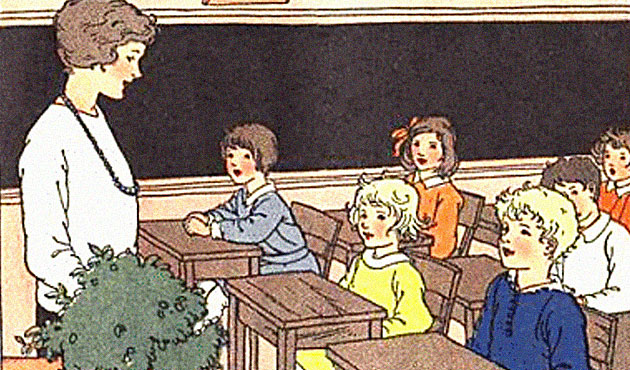Dans le cadre du Salon du livre du Grand Sudbury, taGueule parrainera une table ronde sur l’absence du français dans la place publique le samedi 12 mai 2012 à 15 h. Ce n’est pas d’hier qu’on en discute : le 25 octobre 1999, Normand Renaud livrait ce billet en réaction à la nouvelle qu’une cour du Québec avait jugé inconstitutionnelle une section de la loi québécoise qui exige la prédominance du français dans l’affichage commercial. Curieusement, ça lui a fait penser au hockey.
Imaginez un tournoi de hockey entre deux équipes très inégales, non pas à cause de leur talent, mais à cause du règlement. Dans le tournoi que j’imagine, une équipe a droit à trente joueurs, et l’autre, à trois. Que voulez-vous, c’est la règle du jeu. La saison commence et l’inévitable arrive. Malgré les efforts héroïques des minoritaires, l’équipe favorisée mène bientôt au classement avec 909 victoires et 2 défaites. Mais le jeu est juste, car on en suit le règlement.
Tout ça dure longtemps, mais ne fait qu’un temps. À la longue, la grosse équipe trouve le jeu aussi injuste que la petite. À force de réduire ses adversaires en purée, on se beurre de purée soi-même. Ça, ça s’appelle la mauvaise conscience. On en perd jusqu’au goût de gagner.
Ce n’est qu’après tout ça qu’un beau jour, les maîtres du jeu décideront de changer la règle. C’est dur à admettre, mais ils l’admettent : leur règle est déréglée, leur justice est injuste, leur gloire est une honte. Ils proclament donc une nouvelle règle révolutionnaire : le jeu à forces égales. Mais s’ils changent la règle, ils se gardent bien de changer le compte des points. Les meneurs auront toujours droit à l’avance qu’ils ont gagné fair and square sous l’ancienne règle. Et que le jeu continue !
Ce qui paraît absurde en parlant du hockey ne l’est pas du tout en parlant de la société. À la fin du 20e siècle, le Canada est encore pour beaucoup le pays que son passé de privilèges britanniques a façonné. Ce n’est pas par accident que le Canada est aujourd’hui un pays anglais et que les Canadiens-Français, majoritaires au départ, sont minoritaires à l’échelle du pays et dans toutes les provinces sauf une. Ce n’est pas par accident que le principe qui a affirmé l’égalité des deux langues officielles a aussitôt infirmé les efforts faits au Québec pour effacer les acquis du nationalisme britannique d’hier. Si la majorité a changé les règles du jeu politique, ce n’était pas pour y perdre aux éliminatoires. Alors que l’affichage commercial en français est absent partout au Canada, les lois qui le favorisent dans la seule province où il existe sont combattues. La loi du Québec sur l’affichage en français passe pour un affront à la règle suprême, généreuse et moderne de la société canadienne : l’égalité des deux langues officielles. Elle mérite l’intervention de l’arbitre judiciaire et des punitions majeures pour rudesse.
Mais si le Canada veut vraiment la justice à l’avenir, il lui faut corriger l’injustice du passé. C’est ce que le Québec essaie de faire. C’est ce que le reste du Canada pourrait faire à sa manière. Les grandes villes bilingues du pays, Ottawa-Carleton et Sudbury en tête, pourraient se donner des politiques pour promouvoir l’affichage commercial en français. Étant donné qu’elles voudraient l’égalité de droit pour la minorité anglo-québécoise, ces villes pourraient exiger l’égalité de fait pour leur propre minorité franco-ontarienne. Elles pourraient combattre l’entorse à la règle de l’égalité, quand c’est l’indifférence du peuple et non la loi du peuple qui l’impose. Ce serait une manière de ramener à sa destinée bilingue un pays que le jeu du privilège britannique a si longtemps dévoyé.
Si le Québec agace tellement l’opinion canadienne, ce n’est pas parce qu’il maltraite sa minorité. C’est parce qu’il exerce à son tour et à son compte le plus arrogant des privilèges en politique : celui de fixer les règles du jeu. On a beau dire autrement, en matière d’affichage commercial, le principe canadien de la liberté est au service du privilège universel qu’est la loi du plus fort. Le Québec n’accepte pas de jouer ce jeu-là. Sa politique sur l’affichage loge à l’enseigne de l’égalité. C’est une enseigne française.