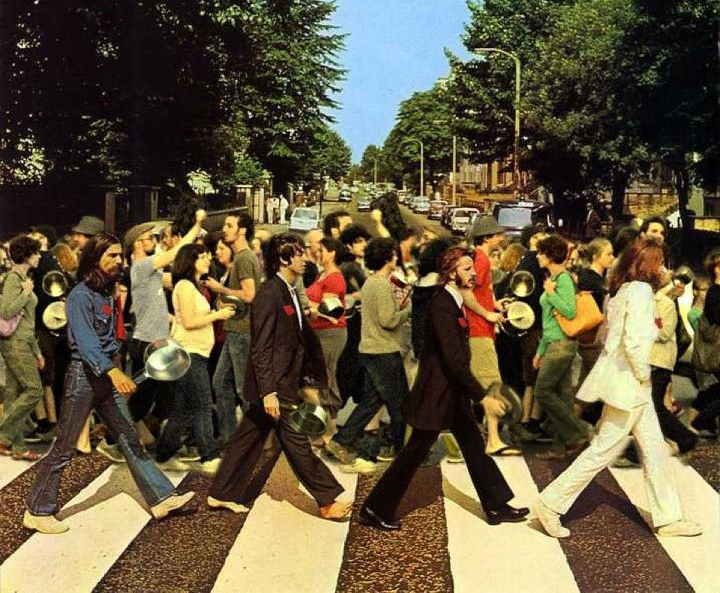Statistique Canada vient de publier une nouvelle étude tirée des plus récentes données du recensement sur la langue. Dans L’évolution du bilinguisme français-anglais au Canada de 1961 à 2011, les auteurs observent que la proportion de Canadiens pouvant soutenir une conversation en français et en anglais «a quelque peu décliné pour la première fois après quatre années de croissance consécutives». Ce type d’étude peut parfois être très éclairant, en proposant des portraits statistiques qui mettent en perspective des perceptions souvent partagées dans la population, mais dont il est difficile de rendre compte. Toutefois, le principal défaut de ces études de Statistique Canada est l’absence d’analyse des résultats obtenus. Je propose quatre pistes d’analyse qui mériteraient certainement d’être approfondies.
Premièrement, il est très préoccupant que de moins en moins d’étudiants anglophones à l’extérieur du Québec soient exposés à l’enseignement du français langue seconde. Cette tendance est très pernicieuse, surtout dans le contexte où le discours officiel et institutionnel souligne à grands traits que l’avenir de la dualité linguistique au Canada passe par les jeunes. Or, «les jeunes anglophones de l’extérieur du Québec sont de moins en moins bilingues». On pellette par en avant, mais voilà que ceux à qui incombera cette tâche n’ont plus de pelles! Dans ce cas-ci, il faudrait poser la lorgnette sur le travail des gouvernements provinciaux, dépositaires de la compétence constitutionnelle en éducation. N’est-ce pas eux qui permettent que l’exposition au français langue seconde soit réduite dans les curriculums? Pourquoi réduire cette exposition? Par souci d’économies? Pour privilégier des matières plus vendables sur le marché du travail en leur consacrant plus de temps en classe? Par manque d’enseignants qualifiés? C’est à se demander aussi si le volet Apprentissage de la langue seconde du programme Mise en valeur des langues officielles de Patrimoine canadien n’est pas en train de rater ses cibles et si l’argent reçu par les gouvernements provinciaux pour offrir de tels programmes est réellement utilisé à cette fin.
Deuxièmement, si la proportion de nouveaux immigrants reçus à l’extérieur du Québec qui ne parlent pas le français augmente, il y a peut-être lieu d’interroger Citoyenneté et Immigration Canada, qui tarde à respecter les engagements qu’il a pris à l’égard des communautés francophones en situation minoritaire. Année après année, les cibles de nouveaux immigrants francophones dans ces communautés fixées par le gouvernement canadien ne sont pas atteintes. Or, il ne faut certainement pas incomber la faute aux nouveaux arrivants, mais bien à ceux qui les sélectionnent. L’étude ne fait pas référence aux critères de sélection des immigrants, la langue n’étant qu’un item parmi tant d’autres dans le système de points établi par le gouvernement fédéral. C’est donc en aval de la sélection qu’il est nécessaire d’agir. Dans la nouvelle mouture de la Feuille de route pour les langues officielles présentée par le gouvernement canadien, 120 millions de dollars sont consacrés à de nouveaux programmes de formation linguistique pour les immigrants économiques. Après les montants consacrés à l’enseignement des langues officielles, il s’agit du plus important poste de dépense de la Feuille de route. Il est permis d’espérer qu’un montant aussi important permettra effectivement d’augmenter la proportion d’immigrants pouvant utiliser le français à l’extérieur du Québec. Il faudra suivre de près l’évaluation de ces programmes et les données du prochain recensement pour en mesurer les effets.
Troisièmement, l’étude évite de répondre à la question «qui est bilingue?» Bien qu’elle y fasse brièvement référence, elle ne s’attaque jamais à cette question de front. La proportion de personnes bilingues n’est pas répartie équitablement entre les personnes de langue maternelle française et anglaise. Il est clair que la proportion de francophones bilingues est beaucoup plus importante, particulièrement dans ce que l’étude qualifie de «zones de contact», concept édulcoré s’il en est un. L’étude souligne que c’est dans ces zones que l’on retrouve la plus forte proportion de personnes bilingues, mais aussi que ce sont les francophones qui y sont proportionnellement plus bilingues. L’étude banalise cette situation, alors que si ce sont les francophones qui sont les plus bilingues dans ces zones, c’est qu’ils en ressentent le besoin beaucoup plus que les anglophones. Autrement dit, les francophones considèrent que leur langue ne suffit pas pour continuer à évoluer dans ces zones de contact, ce qui ne fait pas nécessairement partie de l’équation chez les anglophones. Ce sont donc les francophones minoritaires qui assument principalement les coûts associés au bilinguisme. Pourtant, en cherchant à traiter symétriquement les deux communautés linguistiques, on gomme du même coup cette distinction importante.
Finalement, l’étude note que la croissance de la population bilingue est plus rapide au Québec qu’ailleurs au Canada. Si le ton de l’étude laisse entendre que Statistique Canada se réjouit de cette situation, il est à croire que la réaction ne sera pas la même du côté du gouvernement du Québec. Somme toute, il pourrait y voir un échec de ses propres politiques linguistiques en raison des pressions exercées par le régime linguistique fédéral. Il pourrait même se servir des résultats de cette étude pour justifier la révision de son propre régime linguistique, qu’il a d’ailleurs déjà entamée avec son projet de loi 14. L’objectif du régime linguistique québécois n’est certainement pas d’accroître le taux de bilinguisme individuel, mais bien de préserver le statut du français sur son territoire. Dans ce contexte, de telles données peuvent paraître préoccupantes.
Avant de terminer, il y a tout de même lieu de souligner le travail des deux auteurs de l’étude. Malgré ses défauts, l’étude sonne l’alarme et met en lumière des tendances que gouvernements et acteurs de la société civile doivent renverser. En utilisant les données de huit recensements depuis 1961, ils réussissent à inscrire leurs observations dans la durée. À nous, maintenant, de les contextualiser et de les analyser.