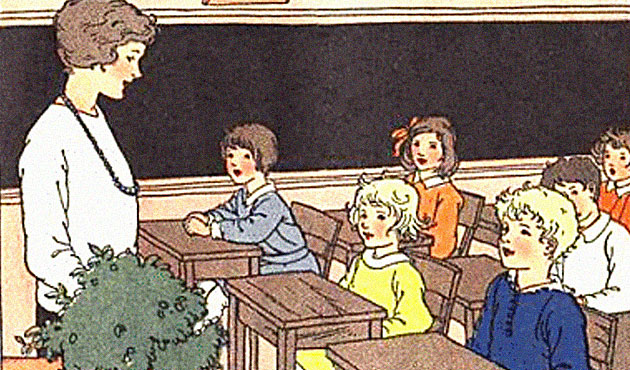Ceci est une réponse à l’article Immigration: le Nouveau-Brunswick est-il xénophobe? par David Caron publié le 22 février 2012.
C’est un drôle de titre qu’a choisi de donner David Caron à son article : le Nouveau-Brunswick est-il xénophobe. Drôle, premièrement, parce qu’il annonce qu’il parlera du Nouveau-Brunswick, mais parle essentiellement de l’Acadie, comme s’il s’agissait de la même chose. Deuxièmement, parce qu’à considérer les discours officiels de la province et de l’Acadie via son organe de représentation la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, on cherche en vain la moindre trace de xénophobie. Qui donc est xénophobe si ce ne sont pas les institutions publiques, les instances de représentation ? On comprend qu’un État puisse avoir des politiques « xénophobe » et on peut attribuer le qualificatif à la population qui les a votées. Il s’en suit généralement un devoir de mémoire. Mais il n’en est rien au Nouveau-Brunswick.
Les discours semblent plutôt faire consensus quant aux bienfaits de l’immigration : on veut que les immigrants viennent. La population de la province décline et vieillie et tous voient, francophones et anglophones, dans l’immigration une bouée de sauvetage, un moyen de garder peut-être pour quelque temps encore la tête hors de l’eau. Xénophobe, donc ? Les élites ne le sont très certainement pas. Est-ce à dire que la xénophobie serait à trouver dans le cœur et l’âme même de tout un chacun ? Et comme il est question d’Acadie dans le texte de Caron, se pourrait-il que l’individu Acadien, par un trait de caractère propre, soit xénophobe, avec preuve à la charge le faible taux d’immigration dans ses villes et villages ?
Une très inégale diversité
On dresse souvent un tableau homogène des communautés francophones hors Québec qui contraste avec le multiculturalisme canadien anglophone – car force est d’admettre au passage que c’est surtout en anglais que se vit le multiculturalisme. C’est un contraste pervers parce qu’il oppose une statistique décontextualisée (un taux d’immigrant de 19 % au pays) à des expériences concrètes et à des chiffres locaux (un taux d’immigrants de 4 % à Moncton). On omet les considérables disparités régionales, la différence entre les milieux urbains et ruraux, anglophones et francophones. Mais des décennies de discours multiculturel promu par le gouvernement ont donné l’impératif noble d’être mondialisés, ouverts sur la différence, quand bien même cette différence ne serait qu’hypothétique, ont donné l’image d’un Canada-mosaïque uniforme d’un océan à l’autre à l’autre.
Trudeau disait du Canada qu’il était le lieu d’un homme nouveau :
« Je crois fermement que les Canadiens sont en train de modeler une société dénuée de tout préjugé et de toute crainte, placée sous le signe de la compréhension et de l’amour, respectueuse de la personne et de la beauté »
Pierre-Elliott Trudeau
En devenant doctrine officielle, le multiculturalisme s’est fait, dans biens des villes et villages, valeur canadienne avant de devenir réalité sociologique et citoyenne. Certaines régions attendent d’ailleurs toujours. Si le NB ne compte que 4 % d’immigrants, contre la moyenne fédérale de 19 %, c’est sans doute, donc, que les habitants de ce coin de pays sont moralement reprochables, empreints encore de préjugés que n’auraient pas les Québécois, les Ontariens, les Britanno-Colombiens, bref les autres Canadiens. Mais ces statistiques canadiennes sont un peu trompeuses. Manifestement notre mosaïque n’est pas tissée du même fil partout.
Montréal, Toronto et Vancouver s’accaparent à elles seules plus des deux tiers des immigrants. Edmonton, Calgary, Victoria, Ottawa, Winnipeg suivent. Pour ne parler que de l’immigration au Québec, la région de Montréal attire trois quarts des nouveaux arrivants et la province s’accapare plus que sa part d’immigrants francophones.
Dès lors qu’on cesse de comparer une province majoritairement rurale ne comprenant que des villes de taille moyenne à une moyenne fédérale, une tout autre perspective se présente. La population combinée des trois principaux centres urbains du NB : Moncton, St-Jean et Fredericton (soit un total de 334 501 habitants) équivalent à trois des dix-neuf arrondissements de Montréal ! Et la province en entier compte moins d’habitants qu’Ottawa !
D’ailleurs, si l’on compare la situation des villes francophones de taille équivalente au pays – elles sont toutes au Québec sauf Sudbury, et j’ajoute St. John’s par souci de comparaison régionale – on se rend rapidement compte qu’elles ne sont pas, elles non plus, des oasis de diversité. En rafale, avec les taux d’immigrants :
- Moncton – 3,4 %
- Sudbury – 6,6 %
- Lévis – 1,5 %
- Trois-Rivières – 2,2 %
- Saguenay – 1,1 %
- Drummondville – 3 %
- Saint-Jérôme – 2,7
- Et à Terre-Neuve, St. John’s – 4 %
Ça commence à faire beaucoup de xénophobes, vous ne trouvez pas ?
L’immigration n’est pas qu’une question individuelle
Ceci étant dit, imputer le faible taux d’immigration (on en parle souvent comme si c’était un travers en soi) à l’ouverture de la « population d’accueil » revient à volontariser un peu trop le processus de migration et d’intégration, et à jeter du revers de la main une littérature entière consacrée aux déterminants sociaux et institutionnels de la « rétention ».
J’essayerai de donner deux éléments de réponse pour comprendre sociologiquement la question, d’autres diront le problème, de l’immigration au Nouveau-Brunswick.
Réseaux informels et complétude institutionnelle
Premièrement, les travaux inspirés par l’École de Chicago en sociologie – je pense, au Canada à Raymond Breton – ont démontré que le parcours d’un immigrant est fortement influencé par les ressources financières, politiques et symboliques dont dispose le groupe auquel il appartient et/ou s’identifie. C’est à lui que l’on doit le concept de « complétude institutionnelle » si utile depuis 40 ans pour les minorités francophones. On parvient, grâce à ce concept, à démontrer que les associations, les médias, les réseaux qui se construisent autour de groupes ethniques ou culturels contribuent non seulement à attirer les immigrants – les Haïtiens se dirigent essentiellement à Montréal et à Miami, les Turcs en Allemagne, les Sénégalais en France, les Chinois à Vancouver – mais déterminent en partie le parcours d’intégration des individus – les Juifs hassidiques d’Outremont ou les Acadiens de Moncton étant des exemples de complétude institutionnelle accomplie qui permet de contrer l’assimilation.
Plus un groupe dispose de ressources permettant à l’individu de satisfaire l’ensemble de ses besoins – commerces, emplois, religion, médias, associations –, plus il sera en mesure d’attirer des membres et moins les individus auront tendance à sortir du groupe et à se fondre dans le « melting pot » ; bref, plus y il a complétude institutionnelle, plus il y aura attraction et persistance de la différence. Sans présence institutionnelle il y a assimilation. Et pour un ensemble de raisons, de tels réseaux ethniques et culturels existent principalement dans les grandes villes, dans les centres économiques les plus dynamiques et sont le résultat d’un long processus ou des hasards migratoires (la migration massive qu’a causée la famine en Irlande au XIXe siècle a permis la mise en place relativement rapide de réseaux Irlandais dans plusieurs villes, notamment par le biais de l’Église catholique).
Le défi d’attirer et de retenir des immigrants est donc d’autant plus grand pour ces milieux plus ruraux, plus périphériques, éloignés des grands centres et de la vie économique. Ces lieux ne sont que rarement des points d’entrée, sont le plus souvent des lieux de transit – voir à ce sujet le film de Dufault et Godbout, Pour quelques arpents de neige qui démontre à merveille la logique de l’immigration et de l’intégration dans les années 1960 : les immigrants débarquent à Halifax et prennent le train vers Montréal. Les provinces maritimes ne seront qu’un espace à franchir, et les traces de cette logique se font encore sentir aujourd’hui.
oehttp://www.onf.ca/film/Pour_quelques_arpents_de_neige_/
Les immigrants qui arrivent dans ces lieux périphériques se retrouvent plus isolés, dans une économie moins diversifiée et une population tissée de liens différents, souvent plus intriqués que celle des grandes villes, à plus forte raison quand il s’agit de groupes eux-mêmes minoritaires. Le(s) tampon(s) qui ailleurs amorti(ssent) le choc d’intégration est moins épais, et parfois carrément inexistant. La pression est mise ailleurs, elle prend souvent une tournure plus personnelle.
Or, multiculturalisme officiel oblige, nous devons tous être ouverts, même si l’ouverture ne prend pour nous qu’un sens abstrait, parce que la diversité est absente de notre quotidien. La diversité devient un genre de conte de fées, de mythe où on imagine un peu bêtement que le contact entre Soi et l’Autre devrait se faire sans heurts, dans la bonne entente et l’harmonie parce que nous sommes tous « dénués de tout préjugé et de crainte ». Comme si nous devions toujours déjà être prêts à recevoir des immigrants, un peu comme nous nous attendons à ce que les immigrants nous arrivent déjà intégrés.
Un tel discours, pour vertueux qu’il soit, ressemble drôlement au discours néolibéral utopique d’une humanité réconciliée dans le marché, unie dans la consommation, dont les différences ne sont jamais de fond, mais de style. Et le style, c’est une question de marché. Alors qu’en réalité, il faut du temps, de l’accoutumance. La rencontre de l’Autre n’est pas toujours sans heurts et sans incompréhensions – en bons francophones, notre histoire faite de luttes pour la reconnaissance et l’égalité devrait nous le rappeler !
Devenir la minorité de la minorité sur un territoire contesté
Il y a ensuite le défi supplémentaire que représente l’immigration au sein de communautés linguistiques minoritaires. Quoi qu’en dise le manifeste de taGueule – « nous ne souffrons pas du syndrome minoritaire » – la minorité est un fait sociologique, elle représente un rapport particulier à un territoire, au pouvoir, à la langue, à la sphère publique, aux médias. Si nous pouvons, individuellement, tous être émancipés, il n’empêche que notre existence collective est irrémédiablement celle d’une minorité démographique ; la francophonie canadienne hors Québec ne cessera d’être minoritaire que le jour où elle cessera d’être francophone. Point.
Le défi qui se pose dans un tel contexte, et le NB en est un bon exemple, est le suivant : deux groupes linguistiques luttent pour l’attraction d’immigrants, deux groupes cherchent à mettre sur pied des structures d’accueil – les francophones veulent des immigrants francophones et les anglophones des immigrants anglophones, chacun cherche à attirer les allophones dans son camp et Dieu sait que la compétition est démesurée quand on se bat contre l’anglais – et cette concurrence inévitable fragmente ultimement les réseaux informels si importants pour l’intégration des nouveaux arrivants.
Le cas de Moncton est marquant : l’Université de Moncton, grâce à ses efforts actifs de recrutement, est parmi les plus diversifiées au pays – 15 % de sa population vient de l’international, contre une moyenne fédérale de 8 %. D’ailleurs, la province occupe le second rang en matière d’internationalisation des universités derrière la Colombie-Britannique. C’est donc que des étrangers viennent, mais ne restent pas. N’est-ce pas là la preuve de la « xénophobie » néo-brunswickoise ?
Un début d’explication se trouve peut-être dans le fait que les efforts faits par l’U de M sont contrés, en un sens, par ceux de la Ville de Moncton. L’U de M recrute en Haïti, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, tandis que la Ville de Moncton, elle, recrute essentiellement des immigrants investisseurs en Corée du Sud. L’espace du campus, qui demeure pour les communautés francophones l’un des chefs lieux de la diversité (à Saint-Boniface c’est le quart des étudiants qui viennent de l’international !), est sans rapport avec l’espace de la ville. Les réseaux internationaux qui se tissent d’un côté ne trouvent pas écho de l’autre. Les deux logiques sont concurrentes malgré elles, notamment parce que les francophones et les anglophones ne recrutent pas les mêmes immigrants – il suffit de faire un tour dans les universités des deux langues pour s’en rendre compte – et surtout, ils ne cultivent pas les mêmes attentes. Ils ne peuvent pas cultiver les mêmes attentes. On demande à l’immigrant francophone de participer à la vie de la communauté francophone, mais sa réalité doit transiger avec l’anglais. Cet équilibre constant n’est pas pour tout le monde, et n’est pas une réalité pour les immigrants qui font le choix de l’anglais. Il y a une asymétrie indéniable.
Et puis il y a la tentation du Québec, qui promet un contexte linguistique plus simple, une métropole multiculturelle et un fast track vers la résidence permanente. Le Nouveau-Brunswick, et en particulier l’Acadie, est en manque de moyens face à une telle concurrence.
Être… ici on le peut
Enfin, comme le souligne David Caron, la province se hisse au sommet d’un honteux palmarès, qui n’y est pas pour rien dans la situation et dont les premières victimes ne sont pas que les immigrants. Palmarès qui ne fait que rajouter à l’ironie du slogan de la province, payé au prix effarant de 1 million $ et qui a récemment été retiré, après une brève existence : « Être… ici on le peut ».
Bref, peut-être existe-t-il de la xénophobie dans la province (et j’aurais tendance à croire qu’elle est plutôt linguistique que raciale ou ethnique), mais l’hémorragie démographique à laquelle fait face la province s’expliquerait sans doute mieux par son économie chancelante, par son profond clivage intérieur entre les deux groupes linguistiques officiels, et par l’emprise de la famille Irving sur l’économie et la presse (une situation à peu près unique au sein des pays développés) qui rendent périphérique les débats publics et les choix de société, que par un défaut moral de sa population.
La province fait du sur place depuis trop longtemps, stagne dans ses divisions internes et dans son absence de vie civique significative. À moins qu’une nouvelle conscience citoyenne émerge et puisse se manifester dans des espaces publics ouverts, la province risque d’avoir autant de mal à accueillir des immigrants qu’à retenir sa population.
Mathieu Wade
Acadien, doctorant en sociologie à l’Université du Québec à Montréal
Photo: Pour quelques arpents de neige, ONF, 1962