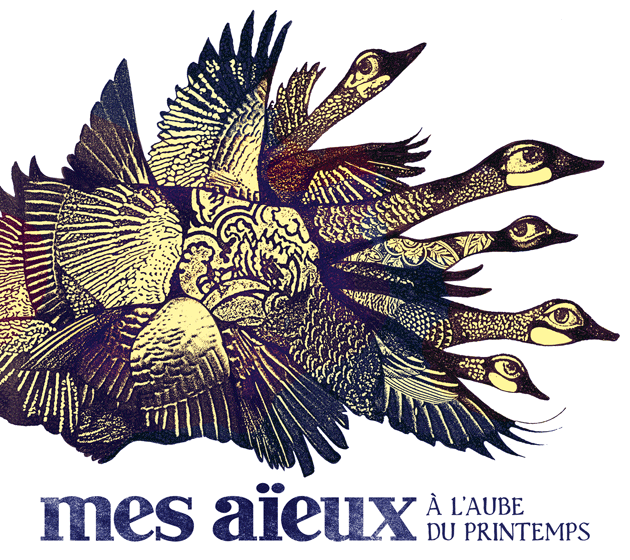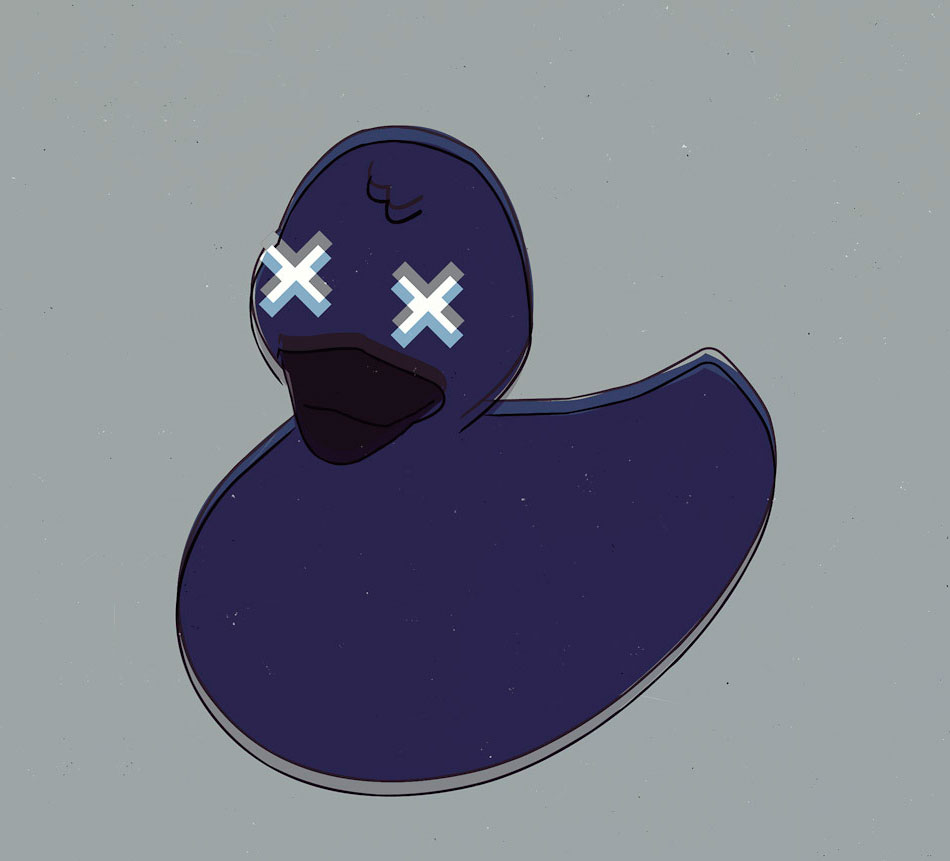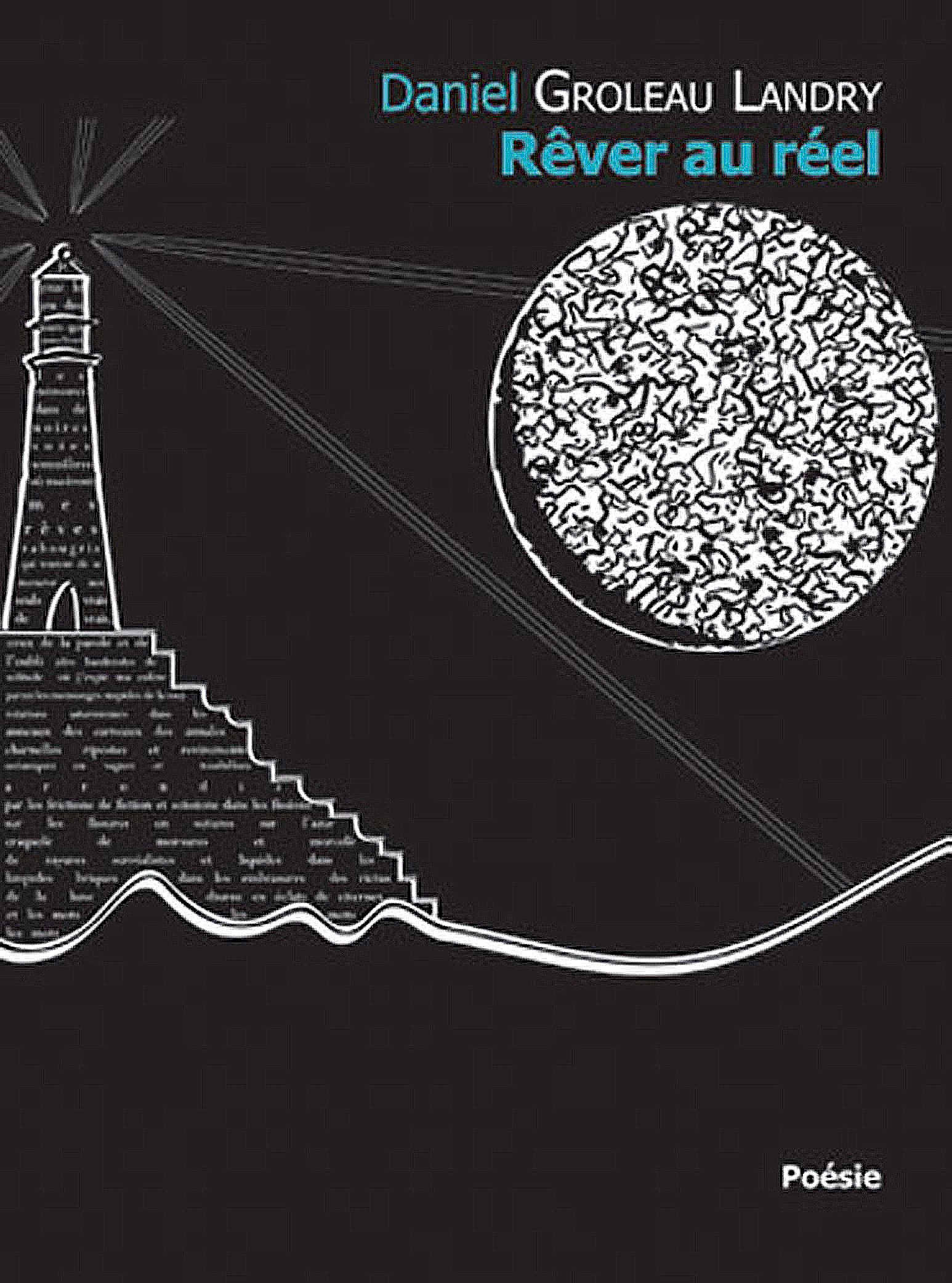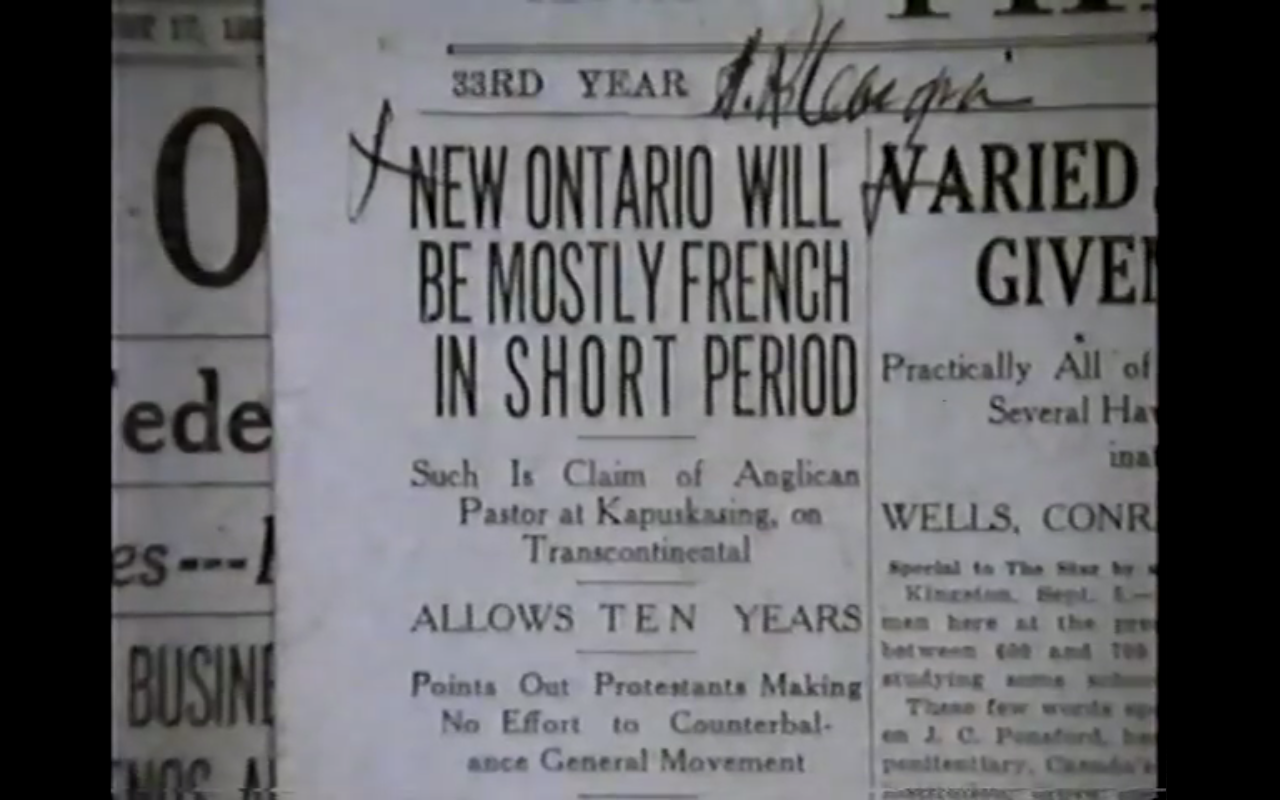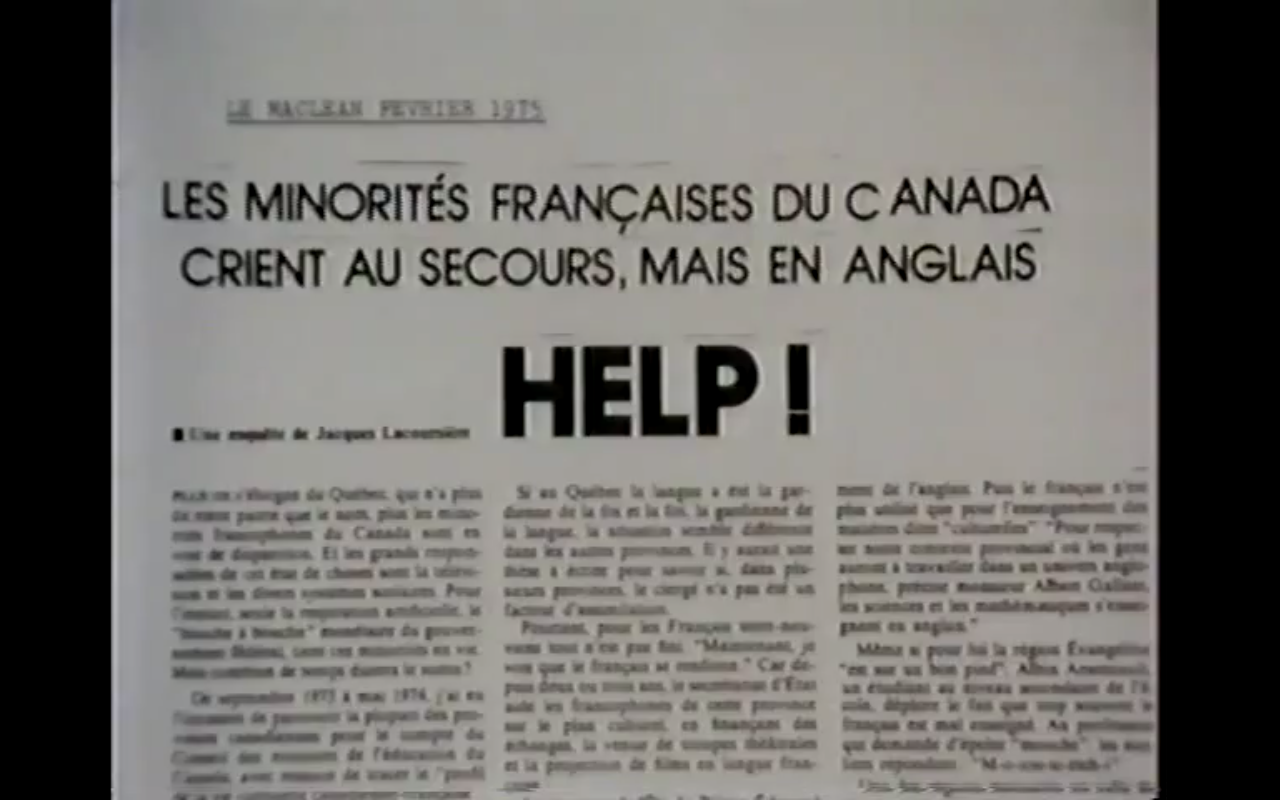C’était en 2000. Un groupe osait tripoter l’ADN québécois à même son folklore. Quelques puristes ont fait la grimace tandis que les autres applaudissaient ce vent de fraîcheur inusité et hautement théâtral. 13 ans et 650 000 albums vendus plus tard – merci à Dégénérations, chanson valant à elle seule trois années de bac en sociologie -, plus personne ne doute de la pertinence de Mes Aïeux. Et ils sont de retour…
À l’aube du printemps, vous avez les deux pieds dans la neige brune et la boue quand, soudain, vous levez les yeux au ciel pour y apercevoir une volée d’outardes. Un ballet majestueux où les oiseaux se relaient sans orgueil en tête du peloton afin de maintenir le cap et le rythme. Une image forte qui aura guidé Stéphane Archambault et sa bande dans l’écriture de ce cinquième album résolument en phase avec son époque, où l’on attend encore des leaders inspirants.
Dès l’ouverture, on nous prend à bras-le-corps : Viens-t-en incite à la mobilisation, au mouvement. Crescendo délicat, on emboîte le pas et on aura bien besoin de cet élan pour piquer à travers les chansons suivantes comme autant de nuages dans l’horizon. Le gris domine et les questions essentielles abondent: «Quelqu’un sait-il où on s’en va ?», «À l’autre bout du pont, qu’est-ce qui m’attend ?» (En ligne), «Y a-t-il un sens à ta vie ?» (Des réponses à tes questions). Le principal intéressé ne trouvera pas, même après avoir interrogé père, mère, prof, psy et curé. Pas plus de réponses du côté de La Stakose, qui tire sur tout, espérant abattre un coupable qui se trouve peut-être de l’autre côté du fusil. Et on croit trouver un peu de répit avec La berceuse, mais on constate rapidement qu’elle ne sert qu’à nous endormir tandis qu’on pille nos ressources naturelles…
Que ce soit musicalement ou par les termes abordés, Mes Aïeux s’éloigne plus que jamais des racines traditionnelles qui les ont tant inspirés. Oui, l’increvable Yâb’ vient faire son tour (Histoire de peur) et on salue une bastringue moderne et séductrice (Je danse avec toi) mais l’essentiel est ailleurs. On a affaire à un disque profondément ancré dans son époque. Si le résultat est parfois lourd dans le propos, l’humour sauve la mise encore une fois. Et il y a de beaux moments plus légers (Je danse avec toi, Au gré du vent) qui permettent de garder le cap et d’arriver à bon port (Bye bye). On termine le voyage émerveillé par la résilience légendaire des Oies sauvages (la chanson la plus réussie du disque) autant que par ce groupe qui a su demeurer unis, persuadés de la force du nombre sur l’individualisme ambiant et surtout, convaincus que «malgré les défaites, on a encore nos ailes»…
Date de sortie: 12 mars 2012
Pochette: Marianne Chevalier