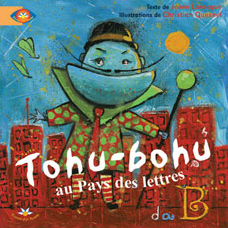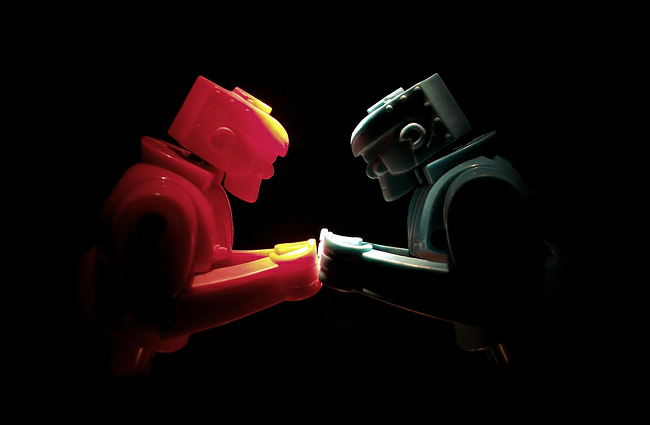Certes, le Code du travail du Québec ne s’applique pas aux étudiantes et aux étudiants en grève et, en ce sens, ils ne peuvent pas être considérés comme des salariés. Pourtant, comme les 20 000 professeures et professeurs de cégeps, les 45 000 employées et employés de la fonction publique ou les 90 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires, pour ne nommer que ceux-là, les étudiantes et les étudiants constituent une catégorie sociale dont les conditions de vie sont largement tributaires des relations, souvent conflictuelles, qu’elle entretient avec l’État québécois.
Depuis la prise en charge de l’Éducation par l’État au début des années 1960, celui-ci en est venu à jouer un rôle déterminant dans le mode de vie des étudiantes et étudiants de l’enseignement supérieur. Les transferts en nature (le financement des frais de scolarité) et en espèces (le programme d’aide financière aux études) sont, en effet, au cœur de la structuration de la réalité financière quotidienne d’un nombre important d’étudiantes et d’étudiants, comme en témoignent les statistiques et les revendications du mouvement étudiant au cours des cinquante dernières années.
À l’automne 2010, il y avait 180 436 étudiantes et étudiants inscrits dans les collèges et 275 472 dans les universités au Québec. Les dépenses globales de l’État par étudiant s’élevaient à 12 756 $ au collégial et à 29 242 $ à l’université1. En 2009-2010, l’aide totale accordée aux étudiantes et aux étudiants en vertu du programme d’aide financière aux études s’élevait à 876,7 millions $. 21,3 % des étudiantes et des étudiants du réseau collégial et 38,9 % de celles et ceux du réseau universitaire bénéficiaient d’une aide. Au total, près de 142 000 étudiantes et étudiants ont bénéficié du programme de prêts et bourses2.
Mais, et c’est ici que ça compte, ces transferts en nature et en espèces occupent, depuis le début des années 1960, une place centrale dans la structure du revenu des étudiantes et des étudiants. En effet, en moyenne, entre le début des années 1960 et le début des années 2000, le quart du revenu disponible des étudiantes et des étudiants provient de l’aide financière aux études. Ce qui en fait, après les revenus tirés d’un travail rémunéré, la deuxième source de revenus en importance3.
Il n’est donc pas surprenant de constater que les luttes étudiantes, surtout depuis la réforme du programme de prêts et bourses en 1966 sous le gouvernement de l’Union nationale, tournent presque essentiellement autour du gel des frais de scolarité et de la bonification du programme d’aide financière aux études.
Le mouvement étudiant québécois déclenche dix grèves générales entre 1956 et 2012. Et si les organisations étudiantes à l’origine de ces mobilisations se sont succédé au cours de cette période, leurs revendications sont demeurées les mêmes. Ainsi, le mouvement étudiant revendique l’abolition ou le gel des frais de scolarité (1958, 1968, 1974, 1978, 1986, 1990, 1996 et 2012). La bonification du programme des prêts et bourses est aussi au cœur des luttes étudiantes au cours de cette période. Le mouvement étudiant réclame entre autres l’instauration d’un présalaire (1956, 1978), la diminution du montant des prêts au profit d’une augmentation de celui des bourses (1968, 1974, 1978, 1988 et 2005), l’abolition de la contribution parentale et de celle de la conjointe ou du conjoint (1974 et 1978) et, de façon générale, la fin de l’endettement étudiant.
À travers leurs moyens d’action, leurs modes d’organisation et leurs revendications, les étudiantes et les étudiants ne visent pas seulement une accessibilité plus grande aux études supérieures et un élargissement des droits sociaux qui sont rattachés à leur statut, mais surtout une contestation des normes régissant leur existence au cours de cet instant précis de leur vie, car, et on l’a vu, les transferts de l’État en enseignement supérieur jouent un rôle déterminant sur le mode de vie d’un nombre significatif d’étudiantes et d’étudiants. Par conséquent, lorsque l’État décide de modifier unilatéralement le financement de l’éducation supérieure, par un dégel des frais de scolarité ou par une modification du programme d’aide financière aux études, il affecte profondément les façons de vivre, comme se loger, se vêtir et se nourrir, des étudiantes et des étudiants.
Somme toute, tout comme les autres groupes sociaux qui négocient leurs conditions de vie avec l’État, les étudiantes et les étudiants forment une catégorie sociale qui défend ses intérêts face à un État qui, trop souvent, définit seul les contours de leurs conditions de vie.
Quelques jalons historiques : 1956-2012
Octobre 1956
1 000 étudiantes et étudiants marchent sur le Parlement à Québec. Elles et ils revendiquent l’abolition des frais de scolarité et du système de prêt étudiant, l’institution d’un présalaire étudiant et, plus largement et à plus long terme, la gratuité scolaire à tous les niveaux d’enseignement.
Mars 1958
Environ 21 000 étudiantes et étudiants universitaires sont en grève générale illimitée pour dénoncer le gouvernement de Maurice Duplessis qui refuse de négocier. Parallèlement, une étudiante (Francine Laurendeau) et deux étudiants (Jean-Pierre Goyer et Bruno Meloche) occupent les bureaux du premier ministre.
oehttp://www.onf.ca/film/histoire_des_trois
Septembre 1961
Adoption par l’Association générale des étudiants de l’Université de Montréal (AGEUM) de la charte de l’étudiant universitaire. Il s’agit d’une adaptation québécoise de la Charte de Grenoble du mouvement étudiant français. Selon certains, c’est la naissance du syndicalisme étudiant.
13 mai 1964
Création du ministère de l’Éducation à la suite des travaux de la commission Parent.
Novembre 1964
Fondation, au Centre social de l’Université de Montréal, de l’Union générale des étudiants du Québec (UGEQ). La nouvelle organisation revendique l’abolition des frais de scolarité, la reconnaissance des étudiantes et des étudiants comme de jeunes travailleurs intellectuels ayant droit à un salaire, la cogestion et la création de nouvelles institutions publiques.
Octobre 1968
Le 12 octobre, une quinzaine de cégeps, certaines facultés et certains départements universitaires sont en grève générale illimitée pour réclamer une meilleure planification de l’accessibilité au marché du travail, la gratuité scolaire, la création d’une deuxième université de langue française à Montréal, la bonification du programme des prêts et bourses, la cogestion et l’abolition de la politique des présences obligatoires au cégep.
Le 21 octobre, 10 000 étudiantes et étudiants participent à une manifestation à Montréal. Celle-ci est suivie d’une nouvelle vague de grèves et d’occupations en novembre. Des lock-out sont décrétés aux cégeps Édouard-Montpetit, de Chicoutimi et de Jonquière.
À la suite de cette mobilisation, les frais de scolarité sont gelés jusqu’en 1990.
Mars à septembre 1969
Dissolution de l’UGEQ, de l’AGEUM et de l’Association des étudiants de l’Université Laval (UGEL). Certains leaders du mouvement étudiant d’octobre 1968 considèrent, malgré les gains, que cette mobilisation fut un échec.
Automne 1974
Un premier mouvement de grève s’amorce le 9 octobre aux cégeps de Rosemont, de Joliette, de Rouyn-Noranda, de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean pour réclamer le retrait des tests d’aptitude aux études universitaires (TAEU). Le gouvernement du Québec retire les TAEU.
En novembre, une nouvelle mobilisation voit le jour au cégep de Rimouski afin d’abolir les frais de scolarité et d’améliorer le système des prêts et bourses (suppression de la contribution parentale et de celle du conjoint, diminution de la contribution de l’étudiante et de l’étudiant et diminution du montant maximum du prêt de 700 $ à 500 $). Le mouvement de grève gagne rapidement du terrain et une trentaine de cégeps y adhèrent, en plus de certaines écoles secondaires et des départements universitaires. Environ 100 000 étudiantes et étudiants sont alors en grève.
Dans la semaine du 9 au 14 décembre, la police antiémeute intervient dans plusieurs cégeps, à la demande des administrations locales qui tentent de briser la grève par le recours au lock-out.
22 mars 1975
Fondation de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Québec (ANEEQ) à l’Université Laval.

Automne 1978
En abandonnant ses promesses électorales en matière d’éducation (gratuité scolaire à tous les niveaux et instauration d’un présalaire pour les étudiantes et les étudiants), le gouvernement péquiste mobilise les troupes étudiantes.
Le 7 novembre 1978, les étudiantes et les étudiants du cégep de Rimouski votent pour la grève générale illimitée. Elles et ils sont suivis quelques jours plus tard par celles et ceux de Chicoutimi et de La Pocatière. Le 23 novembre, on compte une trentaine d’établissements impliqués dans le mouvement. Le même jour, une manifestation de 1 500 personnes, qui se tient devant les bureaux du ministère de l’Éducation à Montréal, se transforme en occupation improvisée.
Les étudiantes et les étudiants de l’UQAM rejoignent le mouvement. C’est la première fois qu’une université est complètement fermée en raison de cet exercice du droit de grève. Plusieurs départements des sciences humaines des universités de Montréal et de Laval décident aussi de joindre le mouvement.
Au total, plus de 100 000 étudiantes et étudiants des collèges et des universités sont en grève générale. Elles et ils réclament l’abolition des frais de scolarité, l’abolition de la contribution parentale et de celle du conjoint, l’abolition de l’endettement étudiant, la diminution de la contribution étudiante et, à moyen terme, la gratuité scolaire intégrale.
Automne 1986
Le 7 octobre 1986, les étudiantes et les étudiants du Vieux-Montréal amorcent un mouvement de grève et revendiquent le maintien du gel des frais de scolarité jusqu’à la fin du mandat du gouvernement Bourassa, le retrait des frais afférents à l’université et une réforme du programme d’aide financière aux études.
Le mouvement regroupe environ 25 associations, dont une seule universitaire, l’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Montréal (AGEUQAM). Plusieurs départements de l’Université de Sherbrooke votent pour la grève, mais les autres composantes ne suivent pas, ce qui empêche le débrayage.
Le 22 octobre 1986, le gouvernement s’engage à maintenir le gel des frais jusqu’en 1989, mettant fin au mouvement.
Automne 1988
Le 26 octobre, plus de 100 000 cégépiennes et cégépiens amorcent une grève de trois jours dans 23 des 44 établissements du Québec pour réclamer une amélioration du régime des prêts et bourses. Cinq autres établissements se joignent par la suite au mouvement.
Le 29 octobre, l’Association nationale des étudiants et étudiants du Québec (ANEEQ) se prononce en faveur du déclenchement d’une grève générale illimitée. Le mouvement s’enclenche avec le ralliement d’une vingtaine d’associations étudiantes, mais certaines, collégiales, s’y opposent.
Le mouvement décline et l’ANEEQ met fin à la grève le 13 novembre. Les cours reprennent dans les cégeps, mais la grève déclenchée le 2 novembre par les 12 000 étudiantes et étudiants des sciences humaines, arts et lettres de l’UQAM se poursuit pendant trois jours.
1990
L’Association nationale des étudiantes et des étudiants du Québec (ANEEQ) et la nouvelle Fédération des étudiantes et étudiants du Québec (FEEQ, qui deviendra plus tard la FEUQ) lancent un mouvement pour s’opposer au dégel des frais de scolarité (les frais universitaires, qui sont de 540 $ – gelés depuis 20 ans – devaient passer à 890 $ l’année suivante, puis à 1240 $ l’année d’après).
Même si la majorité des associations étudiantes n’ont pas obtenu le mandat de grève, les étudiantes et les étudiants en sciences humaines et en arts et lettres de l’UQAM débrayent le 13 mars. Ils sont suivis le lendemain par les étudiantes et les étudiants du Cégep de Rimouski et de l’Université du Québec à Rimouski, ainsi que par celles et ceux des cégeps de Saint-Laurent, de Joliette et de Rosemont.
Plusieurs manifestations, parfois accompagnées d’arrestations, marquent les journées de protestation. Au plus fort de la mobilisation, seulement une douzaine de cégeps et trois universités (l’UQAM, l’UQAR et l’Université de Montréal) étaient en grève. Le mouvement perd de son importance et ne réussit pas à faire fléchir le gouvernement.
1993
Dissolution de l’ANEEQ.
Automne 1996
Les étudiantes et les étudiants du cégep Maisonneuve déclenchent une grève générale, le 23 octobre, pour protester, notamment, contre la possibilité que le gouvernement péquiste hausse les frais de scolarité à l’université et augmente les frais afférents au cégep.
Les cégeps du Vieux-Montréal et Marie-Victorin emboîtent le pas. La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) décident, le 31 octobre, de se joindre au mouvement, qui s’étendra alors à plusieurs établissements.
Le 8 novembre, 23 cégeps sont en grève, soit plus de 60 000 étudiantes et étudiants sur un total de 165 000. Les étudiantes et les étudiants de McGill, de l’Université de Montréal, de Concordia et de l’UQAM rejoignent le mouvement.
La ministre de l’Éducation, Pauline Marois, annonce, dix jours plus tard, le gel des frais de scolarité à l’université et le maintien du plafond des frais afférents au cégep. Le mouvement prend fin le 25 novembre après une vingtaine de jours de grève.
Hiver 2001
Fondation de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) au cégep de Valleyfield.
Hiver 2005
Six cégeps et une douzaine d’associations étudiantes universitaires entrent en grève générale illimitée le 21 février afin de protester contre la conversion de 103 millions $ de bourses en prêts. Environ 185 000 étudiantes et étudiants sont en grève au plus fort de la mobilisation.
La FEUQ et la FECQ en arrivent finalement, après près de 6 semaines de grève, à une entente de principe avec le ministère de l’Éducation, qui consiste à réinvestir 482 millions de dollars de prêts en bourse, pour les cinq prochaines années. Le retour des 103 millions de dollars est promis pour 2006. La FEUQ invite alors ses membres à accepter l’offre pour mettre fin à la grève tandis que la FECQ qualifie l’offre de suffisamment intéressante. La Coalition de l’association pour une solidarité syndicale étudiante élargie (CASSÉÉ), qui a été exclue des négociations avec le gouvernement, invite ses membres à rejeter l’offre de principe et à continuer les moyens de pression.
Sur les 185 000 étudiantes et étudiants ayant participé au mouvement de grève générale illimitée, 110 000 votent contre l’entente, alors que 75 000 l’acceptent. La majorité des associations membres de la FECQ et de la FEUQ entérine toutefois l’entente de principe, d’où l’arrêt rapide de leurs moyens de pression, alors que bon nombre d’associations membres de la CASSÉÉ poursuivent la grève jusqu’au 14 avril.
Hiver et Printemps 2012
Le 13 février, des associations étudiantes lancent un mouvement de grève pour contrer la décision du gouvernement du Québec d’augmenter annuellement de 325 $ les droits de scolarité dans les universités, et ce, pendant cinq ans.
La grève est déclenchée le 13 février 2012 par l’Association des chercheuses et chercheurs étudiants en sociologie de l’Université Laval et le Mouvement des étudiantes et des étudiants en service social de l’Université Laval. Ils sont suivis dès le lendemain par les facultés des sciences humaines, de science politique, de droit et d’arts de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Le 16 février, le Cégep du Vieux-Montréal est le premier à rentrer en grève suivi, le 20 février, par d’autres cégeps qui viennent grossir les rangs des grévistes, qui se chiffrent à ce moment à plus de 30 000. Le 27 février, de nombreuses associations se joignent au mouvement. Il y a plus de 65 000 étudiantes et étudiants en grève. Le 5 mars 2012, le mouvement regroupe environ 123 300 étudiantes et étudiants en grève générale illimitée et plus de 9 500 étudiants ont ce mandat en poche. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants en grève atteint son sommet le 22 mars : 309 000 étudiantes et étudiants sont en grève. Cependant, plusieurs de celles-ci et ceux-ci sont en grève limitée en raison de la manifestation nationale du 22 mars, qui mobilise plus de 200 000 personnes.
La grève étudiante est principalement coordonnée par la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE), par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et par la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ).
En dépit de cette mobilisation historique – la plus imposante et la plus longue – la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp, refuse de négocier avec les organisations étudiantes et nie le processus démocratique à l’œuvre dans les différentes assemblées générales. Le 17 avril 2012, plus de 170 000 étudiantes et étudiants sont toujours en grève.
Au cours de la semaine du 23 avril, il y a eu des discussions entre les leaders étudiants et les délégués gouvernementaux pour abaisser les tensions. Invoquant des incidents lors d’une manifestation le 24 avril à Montréal, la Ministre Beauchamp exclut la CLASSE des pourparlers. En réaction, les leaders de la FEUQ et de la FECQ ont suspendu les discussions avec le gouvernement. Cela a créé une réaction de frustration et une série de 3 manifestations nocturnes se sont déroulées le 24, 25 et 26 avril. La manifestation du 24 avril a été marquée par d’autres actes de vandalisme, commis par un petit groupe des Blacks Bloc, et des arrestations. Néanmoins, les marches se sont déroulées pour la plupart dans le calme.
Le vendredi 27 avril à 11 heures, Jean Charest convoque les médias en conférence de presse pour divulguer l’offre faite aux étudiantes et étudiants. La proposition comprend l’étalement des hausses sur 7 ans, mais aussi son indexation, et un élargissement de l’accès aux prêts étudiants. Cette offre, perçue par la majorité des étudiantes et es étudiants comme une insulte, entraîne une 4e manifestation nocturne consécutive. Le lendemain soir, pour leur 5e manifestation nocturne d’affilée à Montréal, les participantes et participants voient à désormais désapprouver quiconque voudrait s’adonner à la casse. Le 30 avril, une septième manifestation nocturne consécutive a lieu sous le thème d’un «carnaval nocturne» : les participantes et participants sont déguisés et pacifiques. Une autre a également lieu le même jour : la «manifestation lumino-silencieuse», qui se déroule en silence. Pour un neuvième soir de suite à Montréal, le 2 mai, la marche se déroule dans la calme, les manifestantes et manifestants se dirigent vers la résidence privée du premier ministre, où ils font un sit-in, plusieurs déguisés richement, en guise de dérision. Leur principal slogan : «Manif chaque soir, jusqu’à la victoire». Ce jour-là, le ministre des Finances déclarait compter sur les élections plutôt que sur des discussions, afin de régler le conflit, toute négociation étant impossible, selon lui. Le 3 mai, une dixième manifestation nocturne a lieu, certaines manifestantes et manifestants sont déguisés en zombies, d’autres sont presque nus, plusieurs se rendent jusqu’à la résidence du maire de Montréal, qui voudrait leur interdire le port de masques. En date du 14 mai, ces manifestations continuent de se dérouler chaque soir, le compte est donc de 21 manifestations nocturnes.
En raison des manifestations quotidiennes à Montréal, le PLQ décide de déplacer à Victoriaville son Conseil général qui s’ouvre le vendredi 4 mai 2012 à 19 h.
Peu avant l’ouverture du Conseil, le gouvernement Charest décide de convoquer, à Québec, les représentants des quatre groupes d’associations d’étudiantes et d’étudiants, les chefs des centrales syndicales, les recteurs d’université et de la Fédération des cégeps, avec le négociateur en chef du gouvernement ainsi que les ministres Line Beauchamp et Michelle Courchesne, pour conclure une entente de principe visant un retour à la normale. Les représentantes et représentants entament des pourparlers en fin d’après-midi.
Au même moment, à Victoriaville, plusieurs dizaines d’autobus remplis de manifestantes et manifestants se rendent sur place, à environ un à deux kilomètres du palais des congrès. Elles et ils marchent jusqu’à ce lieu où se tenait le Conseil et, moins d’une heure après le début des manifestations, il y a des affrontements entre des manifestantes et manifestants et l’escouade anti-émeute de la Sûreté du Québec. Les négociations à Québec sont alors brièvement interrompues pour permettre aux leaders étudiants de lancer un appel au calme, avec diffusion immédiate jusque sur les réseaux sociaux.
Les affrontements font plusieurs blessés, incluant 3 policiers. Deux manifestants blessés reposent dans un état critique à l’hôpital, dont un étudiant qui perd l’usage d’un œil.
Quelques jours plus tard, deux partis d’opposition, Québec solidaire et le Parti québécois réclament, en vain, la tenue d’une enquête publique indépendante sur le comportement policier lors de la manifestation de Victoriaville. Le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, leur réplique de s’en remettre au commissaire à la déontologie policière.
Le samedi 5 mai, après 22 heures consécutives de négociation, les représentantes et représentants des différents groupes en viennent à une entente de principe, qui stipule que la hausse des «droits de scolarité» s’applique, mais que si des coupures dans les «droits afférents» (frais institutionnels obligatoires) ont lieu, cela pourrait laisser inchangé le total de la facture à payer par les étudiantes et étudiants. À cette fin, l’entente prévoit la création d’un Conseil provisoire des universités (CPU) pour étudier la possibilité de revoir les dépenses universitaires avant 2013. Cette entente est plutôt perçue par les leaders étudiants non pas comme une entente officielle, mais comme une «feuille de route» à soumettre au vote libre des différentes associations étudiantes, de sorte que la grève générale illimitée demeure jusqu’à nouvel ordre. Mais, le parti au pouvoir se fait aussitôt triomphaliste, proclamant que, par l’entente obtenue, le «Québec maintient intégralement les hausses» et le premier ministre, Jean Charest, tient les étudiantes et les étudiants responsables de la durée du conflit. Plusieurs étudiantes et étudiants sur les réseaux sociaux disent que l’entente de principe est une «arnaque» et une «grossièreté». Tous les signes laissent donc croire que l’«offre» sera rejetée par les étudiants. L’impasse est confirmée en moins d’une semaine : les assemblées de chacune des quatre associations rejettent la proposition et la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, se dit prête à ajouter des précisions à l’entente, mais «veut éviter que les gestes qu’elle pose soient perçus comme un «recul» par l’opinion publique», ajoutant (en maintenant sa demande monétaire) que «personne n’a à abandonner ses revendications pour autant».
Au milieu de l’après-midi du lundi 14 mai 2012, à la 14e semaine de grève étudiante, la ministre de l’Éducation et vice-première ministre du Québec annonce sa démission de la vie politique. De son propre aveu, elle espère que cette décision «servira d’électrochoc» en vue de régler le conflit étudiant. Pourtant, dans la matinée, elle avait tenue une conférence téléphonique avec les leaders et porte-parole des quatre groupes d’associations étudiantes, sans faire référence à cette possible éventualité.
Afin de mettre fin au conflit qui oppose le mouvement étudiant au gouvernement du Québec, ce dernier décide de déposer une Loi spéciale (Loi 78) qui, selon la plupart des acteurs de la société québécoise, limite les libertés civiles, menace la démocratie et qui, de surcroît, bâillonne les enseignantes et les enseignants des cégeps. Il est on ne peut plus clair, depuis le dépôt du projet de loi spéciale le 17 mai dernier, que le premier ministre du Québec, Jean Charest, n’est ni le premier ministre de la Jeunesse ni celui de la négociation, mais bien celui de la répression tous azimuts.
Références
1. MELS, Indicateurs de l’éducation – édition 2011, MELS, secteur des politiques, de la recherche et des statistiques, p. 23.
3. Voir : J. Brazeau, Les résultats d’une enquête auprès des étudiants dans les universités de langue française du Québec, Montréal, Département de sociologie de l’Université de Montréal, 1962 ; Robert Ayotte, Budget de l’étudiant des niveaux collégial et universitaire, Québec, Ministère de l’Éducation, direction générale de la planification, 1970 ; Bureau de la statistique du Québec, Enquête sur le mode de vie des étudiants du post-secondaire, Québec, BSQ, 1986; Fédération universitaire du Québec, Étude sur les sources et les modes de financement des étudiants de premier cycle, Québec, FEUQ, 2010.
Mario Beauchemin, La centralité de l’État providence dans le mode de vie des étudiantes et étudiants universitaires au Québec : 1950-1985, Québec, Université Laval, 1991, 139 p.
Benoît Lacoursière, «Brève histoire du mouvement étudiant», Revue Ultimatum, 2005-2006.
Radio-Canada : Les grèves étudiantes au Québec : quelques jalons
Wikipédia : Grève étudiante québecoise de 2005
Wikipédia : Grève étudiante québecois de 2012
Image: Francine Laurendeau, Jean-Pierre Goyer et Bruno Meloche occupent les bureaux du premier ministre