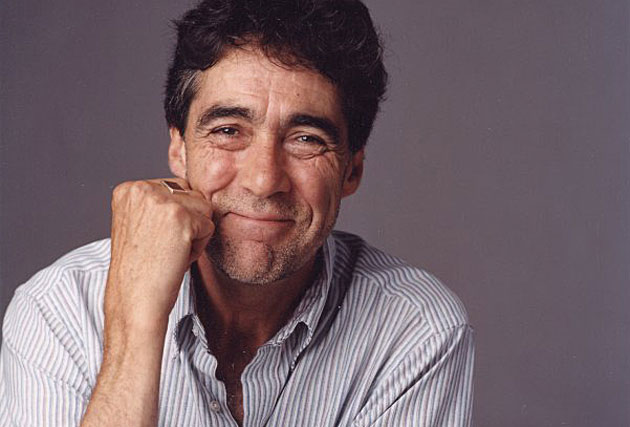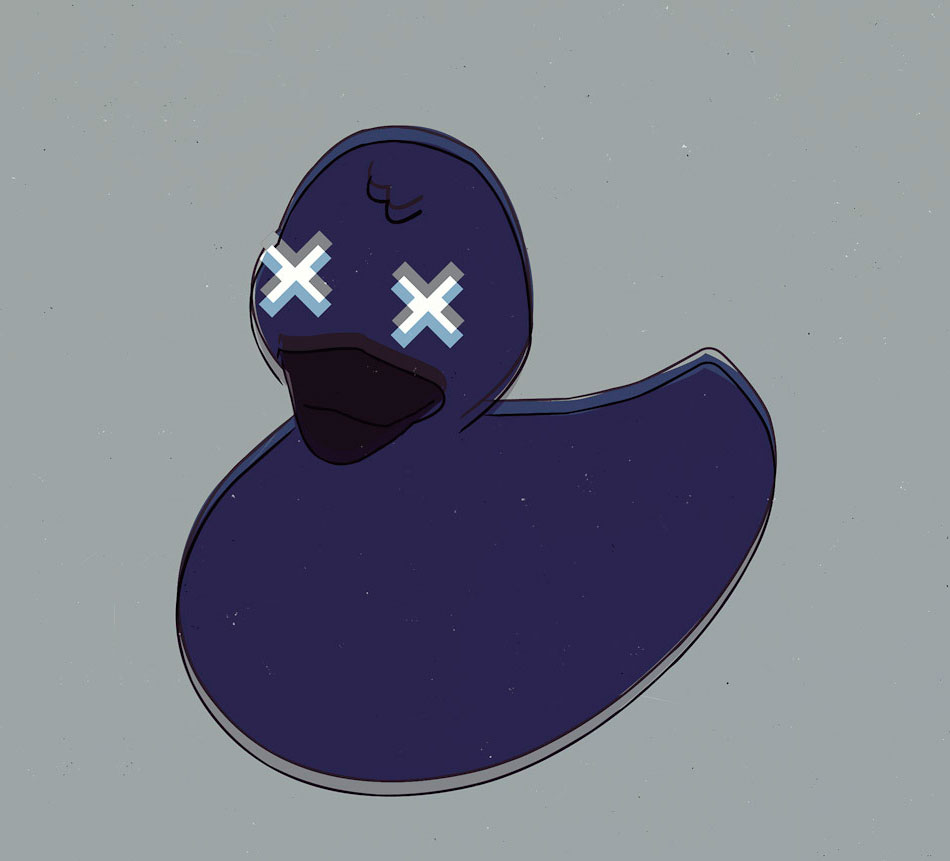Aux États généraux du Canada français de l’automne 1967, presque cent pour cent des délégués du Québec et une petite minorité d’Acadiens ont appuyé une motion favorable au droit du Québec, « territoire national des Canadiens français », à l’autodétermination; les délégués de l’Ouest et de l’Ontario, s’ils ne se sont pas abstenus de voter, s’y sont opposés aux deux tiers environ. On a souvent dit, avec un sens du dramatique, que le Canada français était mort cette journée-là, ou plus exactement que les nationalistes québécois avaient trahi les minorités françaises des autres provinces.
Hors Québec, le récit de la trahison du Canada français par le Québec relève de la vérité historique. Cette trahison est en quelque sorte devenue la blessure fondamentale, une trahison symboliquement équivalente, dans la mémoire, à la déportation des uns et à la conquête des autres. Nul n’a donc été surpris de lire l’expression de ce mythe sur taGueule dans les premières heures, les premiers jours tout au plus, qui ont suivi la renaissance du site. (Note pour les curieux: c’était dans un des commentaires en réponse à l’article du 21 février sur l’université franco-ontarienne.)
Le succès du récit de l’abandon québécois des Canadiens français, et des Franco-Ontariens par la même occasion, s’explique à la fois par son extrême simplicité narrative et sa grande utilité en tant que symbole identitaire. Sur le plan narratif, son simplisme tient dans sa caractérisation sans nuance des personnages : d’un côté les bons, les victimes, les généreux qui tendaient la main; de l’autre les méchants, les bourreaux, les égoïstes qui ont refusé la main tendue. Sur le plan identitaire, ce récit est utile parce qu’il fournit aux Franco-Ontariens un repoussoir, cet Autre dont tout groupement par référence a besoin pour se rappeler ce qu’il n’est pas.
Mais le Canada français a-t-il eu la consistance, la solidité qu’on lui attribue, et l’avait-il encore en 1967? Si oui, peut-on vraiment croire, alors, que son destin se soit joué à l’occasion d’une assemblée populaire, les fameux États généraux du Canada français? Et si la réponse est non, à quoi ce manque de consistance tenait-il?
1. Le Canada Français, le discours et l’agir
Au milieu des années 1970, le sociologue Jean-Paul Hautecœur avait soulevé une certaine controverse en publiant L’Acadie du discours, un essai arguant – je simplifie énormément – que l’Acadie était sans consistance réelle, n’existant que dans les multiples discours à son sujet. Si je ne crois pas, pour les raisons que j’exposerai brièvement ci-dessous, qu’on puisse soutenir un tel argument au sujet du Canada français, je mentionne quand même ce livre parce qu’il nous rappelle de toujours distinguer deux ordres de réalité, celui du monde palpable et celui du discours.
Je dirai d’emblée que le Canada français fut d’abord une abstraction, une idée née de la volonté des anglophones d’assimiler sa minorité de langue française. Au début du XIXe siècle, en effet, au temps des luttes patriotes et réformistes du Bas-Canada, la notion de Canada français n’existait pas. Deux facteurs clés ont toutefois contribué à son invention : les effets d’une forte immigration en provenance des îles britanniques et l’union politique du Bas-Canada et du Haut-Canada. Devenus majoritaires et maîtres incontestés du jeu politique, et par surcroît en processus de détachement par rapport à la Grande-Bretagne (gouvernement responsable, 1848), les Britanniques du Canada-Uni ont commencé à employer le nom Canadians pour se nommer eux-mêmes, accolant du même coup à leurs voisins celui de French Canadians pour bien s’en distinguer. Il faut le souligner : s’il y avait un French Canada et des French Canadians, il n’y avait pas d’English Canada, ni d’English Canadians. Si les Canadiens anglais existent aujourd’hui, c’est parce que les nationalistes québécois les ont inventés.
Le French Canada a pris corps à mesure que les francophones ont intériorisé l’identité que les anglophones leur avaient attribuée. Petit à petit, les premiers Canadiens se sont faits canadiens-français, un processus dont le sociologue Fernand Dumont a magistralement retracé les étapes dans son livre Genèse de la société québécoise. En s’appropriant le nom et l’identité que la majorité leur donnait, ils ont aussi dû se construire une nouvelle référence commune et s’imaginer un nouveau territoire symbolique. L’essence de ce Canada français émergeant s’est résumée au partage de la langue française, de la foi catholique, d’un passé pétri d’héroïsme pieux et de traditions populaires (jamais très clairement énumérées).
Cette construction intellectuelle a eu du succès. Beaucoup l’ont trouvée réconfortante. Le Canada français servit de refuge contre le monde dominé par l’Anglo-Protestant; il fut un prix de consolation pour ceux que l’hégémonie anglo-saxonne bloquait dans leur ascension sociale, politique ou économique. Qu’on ne s’y trompe pas : la petite élite sociale composée de l’évêque, du député, du médecin et de l’avocat avait tout intérêt à croire au Canada français, à le promouvoir et à lui donner corps, car en faisant sa promotion, en lui donnant consistance, c’est sa propre position sociale prééminente qu’elle promouvait et reconduisait. L’invention des Canadians est ainsi devenue une self-fulfilling prophecy à partir du moment où les descendants des premiers Canadiens en ont accepté l’existence. De fait, à force de chercher de multiplier les initiatives pour lui donner corps, on est bel et bien parvenu à donner une certaine consistance à ce Canada français, à ce nouveau groupement par référence qui s’étirait bien au-delà de la vallée du Saint-Laurent, territoire historique des premiers Canadiens. On citera à témoin le chapelet de réseaux associatifs et institutionnels qui se sont développés au fil des ans et des générations. Soucieuse de maintenir sa position dominante au sein de ce groupement référentiel, l’élite sociale du Canada français n’a d’ailleurs pas ménagé les efforts pour étoffer ces réseaux, veillant même à rattraper jusqu’en Nouvelle-Angleterre ceux et celles qui s’en étaient extraits en émigrant.
2. Le Canada Français à l’épreuve du changement social
Loin d’avoir été imperméable au changement social induit par la modernité, malgré ce qu’on a souvent dit, le Québec francophone fut au contraire aspiré par celui-ci, participant aux grands mouvements et s’inscrivant dans les grands courants. La complexité et la force d’entraînement du changement social qui découlaient de ces courants ont donné du fil à retordre aux chantres du Canada français. Personne, en effet, n’était soit au Canada français, soit ailleurs; les références des uns et des autres se mélangeaient, s’emmêlaient. À la ville – entendons Montréal et, dans une moindre mesure, Québec –, le discours paternaliste sur l’existence d’une communauté homogène, pieuse et soudée depuis la Nouvelle-France se heurtait à la présence d’une immigration européenne bigarrée et aux bouleversements causés par le progrès technique.
Les célébrations du Canada français avaient beau se multiplier et résonner, d’autres forces étaient en action. L’idée voulant qu’une communauté de langue française puisse croître, prospérer et vivre en tant que nation ailleurs qu’au Québec se voyait constamment mettre à mal sur les fronts politique, économique et juridique, notamment. Les efforts concertés des catholiques irlandais et des protestants pour éliminer le français en dehors du Québec avaient de quoi ébranler les plus idéalistes. L’indépendance du Québec – ce rêve un peu fou hérité des Patriotes – fut régulièrement remise à l’avant-plan : par Jules-Paul Tardivel dans son roman Pour la patrie en 1895, par le député Joseph-Napoléon Francœur dans une motion législative en 1917, par la revue L’Action nationale en 1922 et encore par les corporatistes des Jeunesses patriotes dans les années 1930. Le discours ambiant sur la valeur de l’identité nationale canadienne-française n’empêcha pas ces gens, à la lumière des faits qui leur paraissaient les plus significatifs, d’imaginer en toute bonne foi, pour eux-mêmes et leurs descendants, un avenir qui passerait par le charcutage du territoire de référence du Canada français.
3. Le provincialisme canadien et l’intégration continentale
Il n’y eut pas que les rebuffades politiques, économiques et juridiques qui lézardèrent le bel édifice du Canada français fait de passé, de langue, de foi et de traditions. D’autres causes ont agi, que je présenterai ci-dessous. Les deux premières nous renvoient au développement du provincialisme au Canada et la troisième à l’intégration continentale nord-américaine par la culture populaire.
Premièrement, les politiques sociales d’après-guerre ont eu pour effet d’accentuer la présence du gouvernement provincial dans la vie des citoyens. En 1945, une fois la paix revenue, le Canada a pris le virage du keynésianisme en matière socioéconomique. Les gouvernements ont mis sur pied un authentique État-Providence, investissant massivement afin de multiplier les services sociaux et d’améliorer les conditions de vie générales de leurs populations. (Ce fut moins vrai au Québec, mais cela est sans importance pour ce texte.) En vertu des compétences exclusives en matière d’affaires sociales que leur reconnaissait l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, les gouvernements provinciaux ont acquis une place considérable dans la vie des citoyens. Dans la même veine, en éducation cette fois, Sudbury vit le collège Sacré-Cœur, établissement chargé d’assurer la reproduction sociale de l’élite franco-ontarienne sudburoise, se transformer en université bilingue et initier la création de l’Université Laurentienne afin de pouvoir accéder indirectement à du financement provincial pour ses activités. Pour les Franco-Ontariens, en santé, en éducation et en d’autres domaines encore, les appels à Queen’s Park ont remplacé les campagnes de souscription populaire d’antan organisées par le curé ou avec sa bénédiction. Du coup, la solidarité nationale canadienne-française devint moins nécessaire ou urgente, donc plus susceptible de s’étioler.
Deuxièmement, la démocratisation de la voiture et l’expansion du réseau routier ont fait en sorte de progressivement relier les grandes villes, les petites villes et les villages. Le nombre de véhicules immatriculés en Ontario a grimpé de 4 200 environ, en 1910, à plus de 562 000, en 1930. Dans le cas particulier de la région de Sudbury, une route entre Sault-Sainte-Marie et Ottawa, accessible aux Sudburois, existait déjà début des années 1930. Quant au lien routier avec Toronto, on a fini de l’asphalter dans les années 1950. Sous l’effet des nombreux chantiers du ministère provincial de la Voirie ou des Transports, chaque grande ville s’est muée en pieuvre aux tentacules de bitume, attirant vers elle les plus petites agglomérations. Toronto l’est devenue pour Sudbury et Sudbury pour la myriade de petites villes et de villages tout autour. De moins en moins isolées, les petites localités canadiennes-françaises du Nord de l’Ontario se sont vues rattacher à un territoire toujours plus vaste, plus uni et plus anglo-saxon; de nouvelles lignes de communication se sont ouvertes; les distances se sont estompées; les morceaux plus ou moins épars de l’écoumène ontarien se sont liés les uns aux autres. Dans cette foulée, le contact avec l’Anglais s’est accru là même où il avait naguère été quasiment inexistant. En décloisonnant les petites enclaves francophones, l’asphaltage des routes et la multiplication des voitures ont participé à réorienter leur destin et celui de tous les Franco-Ontariens.
Troisièmement, enfin, la radio et la télévision se sont instituées dans la vie des francophones d’Ontario en anglais principalement, quand ce ne fut pas exclusivement. Cette implantation dans les mœurs s’est notamment traduite par une incursion de la culture populaire étatsunienne et Canadian dans le quotidien. La radio canadienne s’est développée à compter de 1922. La première station sudburoise permanente vit le jour au milieu des années trente. À partir de 1947, du français fut occasionnellement entendu sur les ondes d’une station bilingue. La première station entièrement francophone, propriété de Baxter Ricard et affiliée à Radio-Canada, n’a commencé à diffuser qu’en 1957. En ce qui concerne la télévision, elle s’est implantée en anglais à Sudbury à l’automne 1953, un an à peine après son inauguration officielle au Canada. En français, Ottawa a eu son antenne radio-canadienne en 1955, mais le Nord et le reste de la province ont dû attendre plusieurs années.
4. La trahison et le confort de la victime
Personne n’a abandonné ou trahi qui que ce soit lors des États généraux du Canada français. Ce jour de novembre 1967 a fait comprendre et admettre aux plus lucides que les horizons des différentes communautés ne se rejoignaient plus, si tant est qu’ils l’eussent déjà fait ailleurs que dans le discours.
La thèse de la trahison du Québec est néanmoins populaire parce qu’elle autorise un récit victimaire. Se poser en victime, c’est se donner le droit de se plaindre, d’exiger des comptes, des réparations et de l’attention. C’est s’autoriser à justifier sa médiocrité, ses ratés, ses carences. Comme ces Québécois qui aiment bien attribuer leurs divers ratés à l’abandon par la France, à la Conquête, à la domination anglaise ou à Ottawa, des Franco-Ontariens aiment casser du sucre sur le dos des Québécois, surtout s’ils sont nationalistes ou souverainistes, pour expliquer ou excuser l’anglicisation galopante de leur communauté. Et pourquoi s’en priveraient-ils, d’ailleurs? Ils trouveront toujours au Québec des alliés complaisants qui, par attachement sincère ou intéressé au Canada, diaboliseront le mouvement d’émancipation nationale que les Québécois ont hérité des Patriotes ou le réduiront qui à de l’étroitesse d’esprit, qui à de l’ignorance, qui encore à de l’ethnicisme. Le fils de Sudbury qui contrôle le journal La Presse depuis 1967 – quel hasard! – abat d’ailleurs une besogne admirable à cet effet.
Paradoxalement, le ressentiment antiquébécois des Franco-Ontariens est à la mesure de leur désir de reconnaissance aux yeux des Québécois. C’est une donnée normale et habituelle du rapport entre minorité et majorité, facilement observable au Québec à l’égard du Canada et de la France et au Canada à l’égard des États-Unis. Le dur désir de durer, celui-là même qui, de l’autre côté de l’Outaouais, maintient actuelle l’idée d’indépendance, garde en vie le feu du Canada français en Ontario. C’est pour cela que, malgré son caractère de farce politique, la reconnaissance symbolique par la Chambre des Communes d’une sorte de nation ethnique québécoise au sein du Canada uni en 2006 a suscité l’opposition de 77 % des francophones hors Québec et même d’un peu plus encore de Franco-Ontariens. C’est aussi pour cela que, dans la foulée de cette pantalonnade parlementaire, l’hebdomadaire sudburois Le Voyageur a appelé de ses vœux à la reconnaissance d’une nation canadienne-française dont personne, je présume, ne saurait dire en quoi elle consiste. La vigueur de l’opposition franco-ontarienne avait quelque chose de ridicule dans la mesure où les Franco-Ontariens pratiquent eux-mêmes, à l’échelle de leurs moyens limités, un type de souverainisme identique par nature à celui des Québécois. (J’y reviendrai dans un prochain texte.)
Le dur désir de durer, disais-je un peu plus haut. Tout semble toujours y ramener quand on est francophone en Amérique.